L’année de M1 est consacrée à l’approfondissement de la formation en sciences sociales, dans une optique résolument pluridisciplinaire, et à l’initiation aux méthodes quantitative et qualitative en usage dans le secteur des études et du conseil. Les étudiants ont à réaliser un mémoire, impliquant un terrain, encadré par un membre de l’équipe pédagogique. Réalisé en binôme, ce mémoire s’efforce de répondre à une problématique en mobilisant des données qualitatives ou quantitatives, dans l’esprit d’une étude socioéconomique professionnelle.
Dès la première année, une place significative est accordée aux enseignements consacrés à la transition écologique. De plus, les étudiants choisissent une option parmi les deux suivantes :
« Marketing » (MK). Le champ de cette option est l’environnement de l’entreprise : les consommateurs, le marché, l’arène concurrentielle, le territoire d’implantation… autant d’éléments destinés à alimenter un diagnostic stratégique. Associés aux enjeux de la transition écologique, les débouchés de cette option sont : études et conseil en marketing, en marketing durable, étude d’opinion, analyse et conseil en stratégie, diagnostic de territoire et transition écologique, conseil en développement durable…
Voir la vidéo de présentation de l’option « Marketing ».
« Organisation, emploi, travail » (OET). Le champ de cette option est l’intérieur de l’entreprise : son organisation interne, le profil de la main d’œuvre, les formes de la relation d’emploi, les critères de performances, dans le contexte de la transition écologique… Les débouchés associés à cette option sont plutôt : conseil RH, consultant RSE/ESG, conseil en organisation, transformation, reconversion (dont accompagnement à la transition écologique), assistance aux CES, consultant QSE, observatoires des métiers de branche…
Voir la vidéo de présentation de l’option « Organisation, emploi, travail ».
Télécharger la nouvelle maquette des enseignements de M1 (septembre 2025)
Semestre 1
Sauf mention contraire, tous les enseignements de chaque UE sont obligatoires.
UE 1 : Mutations du monde contemporain 1
 |
NOM Statut Université |
Objectifs pédagogiques
Plan du cours
Contrôle des connaissances
Bibliographie de base
 |
Pierre PISTRE Maître de conférences en géographie, Université Paris Cité |
 |
Adrien DORON Maître de conférences en géographie, Université Paris Cité |
Objectifs pédagogiques
À destination de non-géographes et géographes, ce cours magistral a pour objectif de familiariser les étudiantes et étudiants aux enjeux des sociétés contemporaines du point de vue de l’espace géographique, en associant éléments théoriques, réflexions méthodologiques et exemples d’actualité. Il s’agit en particulier de sensibiliser aux grandes mutations des territoires surtout français, de leur organisation spatiale, de leur gouvernance par les pouvoirs publics et au rôle des mobilités spatiales des populations (résidentielles, quotidiennes, de loisir). En d’autres termes, l’enjeu est de comprendre les apports d’une prise en compte de la dimension spatiale des phénomènes humains, notamment socioéconomiques ; de connaître les principales méthodes utilisées pour appréhender l’espace et ses évolutions en géographie et en aménagement ; et de pouvoir synthétiser de façon critique des articles de débats scientifiques relevant de la géographie et de l’aménagement.
Plan du cours
- Étudier l’espace : éléments d’un raisonnement géographique appliqué aux inégalités
- Diviser l’espace : des mailles et des catégories spatiales pour les politiques publiques
- Métropoles versus périphéries spatiales (rurales, périurbaines, urbaines)
- Ville compacte versus Ville diffuse
- Décroissance urbaine : questionner la croissance comme paradigme dominant du développement urbain
- Représentations, identités, imaginaires géographiques comme ressources territoriales
Références bibliographiques
- Blanchard S., Estebanez J., Ripoll F., 2021, Géographie sociale. Approches, concepts, exemples, Paris, Armand Colin.
- Charvet J.P., Sivignon M., 2016, Géographie humaine, questions et enjeux du monde contemporain, Paris, Armand Colin.
- Debarbieux B., 2015, L’espace de l’Imaginaire : Essais et détours, Paris, CNRS.
- Levy J., & Lussault M., 2003, Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin.
- Pumain, D., & Saint-Julien, T., 2010, Les interactions spatiales et Analyse spatiale : les localisations, Paris, Armand Colin
- Géoconfluences (ressources variées en géographie)
- Hypergéo (encyclopédie électronique de géographie en accès libre)
UE2 : Outils et Langues 1
 |
Ryad MANSERI Maître de Conférences Université Paris CIté |
Objectif pédagogique
Ce cours propose de revenir sur les principaux indicateurs de la statistique descriptive (mesures de tendance centrale, de dispersion, etc.), tant en analyse univariée qu’en analyse bivariée. Le cours sera également l’occasion d’aborder des méthodes d’analyse plus avancées, telles que l’analyse géométrique des données et l’inférence statistique (économétrie en particulier), en fonction du temps disponible. L’enseignement s’appuie fortement sur la pratique, avec des exercices réalisés d’abord sur Excel, puis sur R.
À l’issue de ce cours, les étudiants sauront manipuler efficacement des tableaux de données, produire des statistiques pertinentes et les représenter sous forme graphique. Un soin particulier est accordé à l’interprétation des résultats et à la réflexivité, indispensable à toute démarche quantitative.
Plan de cours
- Les statistiques : définitions et enjeux
- Analyse univariée
- Analyse bivariée
- Analyse multivariée : analyse géométrique des données/économétrie
Modalités de contrôle des connaissances Contrôle continu
Évaluation sur table + rendu d’un dossier
Références bibliographiques
- Luc Albarello, Étienne Bourgeois et Jean-Luc Gayot, Statistique descriptive, de Boeck, 2010 (disponible sur cairn).
- Wayne Winston, Marketing Analytics. Data-Driven Techniques with Microsoft Excel, Wiley, 2014.
- James H. Stock et Mark W. Watson, Principes d’économétrie, Pearson, 2014.
 |
Vincent Guillory Au delà des chiffres |
Objectifs pédagogiques
A travers le pack Microsoft Office, application professionnelle la plus populaire, il s’agit de répondre aux besoins en entreprise des étudiants dans le monde des études et du conseil :
- Renforcer son efficacité avec les outils : Excel/VBA, Word et Powerpoint
- Rédiger et présenter un rapport d’étude
- Organiser une communication efficiente.
Plan de cours
Théorie avec mise en pratique
- Excel : Copier/collage spécial, Liste personnalisée, Mise en forme conditionnelle
- Tableau croisé dynamique, Graphiques sparkline, Formules, Données, Macro/VBA
- Word : Styles, Tableau, SmartArt, Filigrane, Table des matières, Publipostage
- Powerpoint : Bonnes pratiques, Masques, Thèmes
Modalités de contrôle des connaissances
La notation se base sur les critères suivants :
- Contrôle de connaissances : 30 %
- Pratique : 70 %
Les cours de langue sont assurés par le département LANSAD (LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines).
Pour plus d’informations : https://u-paris.fr/eila/lansad/
 |
Matthieu GIMAT Maître de conférences en Aménagement de l’espace, urbanisme Université Paris Cité |
Objectifs pédagogiques
Ce cours vise à aider les étudiantes et étudiants à améliorer leur expression à l’écrit. Il est l’occasion de revoir des points d’orthographe et de grammaire ainsi que de transmettre des pratiques assurant la clarté de l’expression écrite. Il permet aussi d’aborder des spécificités de l’écrit au niveau Master, en montrant notamment l’importance de positionner ses propres idées par rapport à celles des autres et en encourageant le développement d’une pratique de la reprise et de la réécriture, dans une optique de professionnalisation. Pour ce faire, les étudiantes et étudiants travaillent à l’aide de la plateforme Écri+.
Bibliographie
En plus des ressources disponibles sur la plateforme Écri+, il est possible de consulter :
- Spicher, A., 2021, Savoir rédiger. Les techniques pour écrire avec clarté et efficacité (3è édition), Paris, Ellipses.
- Becker, H. S., 1986 [trad. 2004], Écrire les sciences sociales, Paris, Economica.
- Dictionnaire Le Grand Robert, accessible sur le site des Bibliothèques de l’université
- La section « Règles de français » du site de l’éditeur Bescherelle
- Une autre façon d’améliorer son orthographe en ligne de façon ludique : Dictaly
UE3 : Transition écologique 1
 |
Eric MAGNIN Professeur d’économie Université Paris Cité |
Objectif pédagogique
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiant.e.s à l’analyse conjoncturelle. Il ne s’agit de permettre aux étudiants de comprendre les notes de conjoncture rédigées par les organismes spécialisés et surtout de construire leurs propres analyses conjoncturelles à partir des données d’un trimestre, d’un semestre ou d’une année. À la fin du semestre, les étudiant.e.s seront capables de rédiger une vraie note de conjoncture.
Plan du cours
I – Introduction : définition et histoire de l’analyse conjoncturelle
II – L’analyse de la croissance
III – Le comportement des ménages
IV – Le comportement des entreprises
V – L’environnement international
Modalités du contrôle des connaissances
Examen final (partiel) : examen écrit de 3h début janvier (100%).
Références bibliographiques
- CLING J.P., L’analyse de la conjoncture, coll. Repères, La Découverte, 1990.
- FAYOLLE J., Pratique contemporaine de l’analyse conjoncturelle, Economica 1987.
- JOBERT T. et TIMBEAU X. L’analyse de la conjoncture, coll. Repères, La Découverte, 2011.
- VAZQUEZ M. (dir.), La conjoncture : des indicateurs aux politiques économiques, La Documentation française, 2002.
 |
Véronique BRESSON ESG Value |
Objectifs pédagogiques
L’objectif de cet enseignement est la transmission d’une méthodologie d’analyse de la performance financière et extra-financière d’une entreprise. Les étudiants intégreront que ces deux analyses jouent un rôle essentiel dans la transition écologique en orientant leurs stratégies vers des pratiques plus durables. L’analyse de la performance passe donc par l’analyse de la profitabilité de l’entreprise mais aussi par l’analyse du bilan et de la trésorerie. Elles permettent de mieux comprendre les risques et les opportunités liés à l’environnement et d’investir dans des projets plus responsables.
Plan du cours
- L’analyse financière
Elle permet de mesurer la rentabilité, la solvabilité et la pérennité d’une entreprise. Dans le contexte de la transition écologique, elle prend en compte de nouveaux critères et facteurs qui influencent la performance économique à long terme.
- L’analyse extra-financière
Elle va au-delà des indicateurs financiers traditionnels en prenant en compte des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG). Cela permet de mesurer la durabilité des entreprises et leur impact sur la transition écologique.
Contrôle des connaissances
Examen écrit intermédiaire sur les notions clés d’analyse financière (50%) + Examen oral d’un cas concret d’analyse extra-financière à présenter en petit groupe maximum 3/4 étudiants (50%).
Bibliographie de base
- Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot, Analyse financière, Gualino , 2024.
- Pascal Quiry, Yann Le Fur, Pierre Vernimmen, Finance d’entreprise, 23e édition, Lefebvre Dalloz, 2024.
 |
Diego LEVY Doctorant en Droit Public Université Paris Cité |
Objectif pédagogique
Cet enseignement vise à transmettre une culture juridique axée sur les grandes questions environnementales contemporaines, immédiatement mobilisable dans un cadre professionnel et dans la vie quotidienne. Il s’agit également d’apprendre aux étudiant(e)s les rudiments de la méthodologie juridique.
Plan de cours
- Une introduction – très – générale au droit
- La construction d’un droit de l’environnement
- Administration et environnement
- La protection de la nature et de la biodiversité
- Gestion et utilisation des ressources naturelles
- Droit, environnement et activités économiques : RSE et devoir(s) de vigilance
- Droit, environnement et activités économiques : environnement et droit financier
- Pollutions et nuisances
- La lutte contre le changement climatique
- Droit et environnements urbains, ruraux, culturels
- Justice environnementale
Modalités de contrôle des connaissances : 100 % contrôle terminal (questions de réflexion)
Références bibliographiques
François Terré, Nicolas Molfessis, Introduction générale au droit, Précis, Lefebvre Dalloz, 2025.
Jessica Makowiak, Michel Prieur, Julien Bétaille, Marie-Pierre Camproux, Hubert.
Delzangles, Grégoire Leray, Véronique Jaworski, Simon Jolivet, Droit de l’environnement, Précis, Lefebvre Dalloz, 2023.
Laurent Fonbaustier, Manuel de droit de l’environnement, Droit fondamental, PUF, 2023.
Gabriel Eckert, Jean Waline, Etienne Muller, Droit administratif, Précis, Lefebvre, Dalloz, 2025.
Michel Degoffe, Droit administratif, Cours magistral, Ellipses, 2025.
Henri Jacquot, François Priet, Soazic Marie, Droit de l’urbanisme, Précis, Lefebvre, Dalloz, 2025.
Marta Torre-Schaub, Les dynamiques du contentieux climatique : usages et mobilisations du droit, Collection de l’institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Mare et Martin, 2021.
UE4 : Itinéraire Marketing
Uniquement pour les étudiants de l’option MK
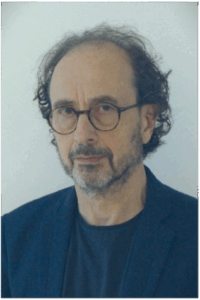 |
Philippe MOATI (cours) Professeur émérite d’économie, Université Paris Cité, L’ObSoCo |
Objectif pédagogique
Aborder les différentes facettes de la consommation (macro, micro), selon différents angles disciplinaires (économie, sociologique, marketing, psychologie économique).
Plan de cours
- L’approche de la consommation des ménages par la comptabilité nationale
- La structure du budget des ménages
- Les déterminants des comportements de consommation
- Les comportements d’achat
- Consommation et bien-être
Modalités de contrôle des connaissances
Examen final : 100 %
Références bibliographiques
-
-
- Benoît Heilbrunn, Peut-on consommer autrement ?, Sciences Humaines, 2023.
- Benoît Heilbrunn et Philippe Moati (eds), Consommer sans détruire : entre messianisme et apocalypse, la voie étroite d’une consommation raisonnable, EMS, Caen, 2025.
- Joël Brée, Le comportement du consommateur, Dunod, Les topos, 2023.
- Michael Solomon, Comportement du consommateur, Pearson Education, 2013.
- Gilles Lipovetsky, Le bonheur paradoxal, Gallimard, 2006.
- Philippe Moati et Robert Rochefort, Mesurer le pouvoir d’achat, la Documentation Française, 2008.
- Philippe Moati, La nouvelle révolution commerciale, Odile Jacob, 2011.
- Philippe Moati, La société malade de l’hyperconsommation, Odile Jacob, 2016
- Daniel Kahneman, Système 1/Système 2 : les deux vitesses de la pensée, Flammarion, 2012
-
UE4 : Itinéraire Organisation, Emploi, Travail
Uniquement pour les étudiants de l’option OET
 |
Sabina ISSEHNANE Maîtresse de conférences en économie Université Paris Cité |
Objectifs pédagogiques
Ce cours propose une analyse approfondie des transformations contemporaines du travail et de l’emploi. L’objectif est de donner aux étudiant·e·s des outils théoriques et empiriques pour comprendre les dynamiques du marché du travail, les inégalités qui le traversent et les politiques publiques qui l’encadrent. Nous mettrons en perspective les transformations récentes de l’emploi : flexibilité, montée de la précarité, chômage, effets des mutations technologiques et écologiques. Une attention particulière sera portée aux inégalités d’accès à l’emploi et aux discriminations liées au genre, à l’origine, à la religion, à l’orientation sexuelle, ou à l’handicap. Nous analyserons également les conditions de travail, la santé au travail et les nouvelles formes d’organisation du travail.
Plan du cours
Le cours abordera les politiques de l’emploi et de la formation professionnelle, en mettant en discussion des controverses actuelles : faut-il baisser le coût du travail ? Peut-on concilier transition écologique et créations d’emplois ? Quelles politiques pour lutter contre les discriminations ?
La dimension appliquée occupe une place centrale : les étudiant·e·s mèneront une enquête de terrain articulant méthodes qualitatives (entretiens, observations) et quantitatives (analyse statistique). Ils mobiliseront ces méthodes pour analyser une question de socio-économie du travail en lien avec les thématiques du cours.
Modalités de contrôle des connaissances (100% contrôle continu)
L’évaluation combinera participation active, travaux collectifs, présentation des résultats d’enquête et rédaction d’un rapport final.
Bibliographie de base
UGHETTO, P., Faire face aux exigences du travail contemporain. Conditions du travail et management, Editions de l’ANACT, 2007.
VATIN, F., PILLON, T., BIDET, A., 2000, Sociologie du travail, Montchrestien, coll. AES, 2000.
HUGHES E.C., Le regard sociologique, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1996.
BIDET, A., BORZEIX, A., PILLON, T., ROT, G., VATIN, F. (dir.), Sociologie du travail et activité, Octarès, 2006.
UE5 : Mémoire d’étude
Réalisé en binôme (ou en trinôme), ce mémoire d’étude s’efforce de répondre à une problématique en mobilisant des données essentiellement qualitatives, dans l’esprit d’une étude socio-économique professionnelle. Tout au long de l’année, le travail sera encadré par Anaïs Henneguelle. Ce cours nécessite une quantité importante de travail personnel entre chaque séance.
Sujet
Le mémoire d’étude doit porter sur une situation de travail particulière (qu’il s’agisse d’un métier particulier, d’une branche, de conditions de travail ou d’emploi spécifiques, etc.), choisie par le binôme d’étudiant·es. Il doit inclure une perspective comparative et un focus spécifique sur les questions écologiques (pratiques, représentations, intégration au travail).
Il s’agit, à partir d’une question clairement formulée au sujet de cette situation de travail :
- De dresser un état des lieux : quelles réponses ont été apportées jusque-là ? Quelles hypothèses de travail peut-on formuler sur cette base ?
- De mobiliser des données (essentiellement qualitatives) susceptibles d’apporter des éléments nouveaux.
- De montrer en quoi ces éléments confirment, complètent, ou réfutent les (différentes) réponses traditionnellement proposées.
L’IA générative donnant aujourd’hui de très bons résultats, il ne s’agira pas d’évaluer en priorité le fond du propos, mais plutôt des compétences très spécifiques, aux premiers rangs desquelles figurent la capacité à synthétiser, à présenter des résultats et à analyser des données qualitatives issues d’un terrain de recherche.
Rendus
Les sujets donnent lieu :
- Au rendu d’une note d’étape le jeudi 18 décembre 2025 (tout retard sera pénalisé d’un point par jour entamé).
- au rendu du mémoire lui-même, obligatoire pour la session 1, lundi 4 mai 2026 (idem).
- à une soutenance publique entre le mardi 19 et le vendredi 22 mai 2026 comportant une présentation de 15mn, suivie d’échanges avec le jury (pour une durée totale de 30
minutes).
Dans une perspective d’économie d’échelle, les entretiens menés pour le mémoire d’étude devront également servir pour l’évaluation du cours de Méthodes qualitatives (enquêtes et entretiens) du semestre 8.
Format
Le mémoire devra répondre à la forme suivante (la taille des différentes parties devra
impérativement être respectée) :
- Résumé des conclusions (2 000 signes). Il s’agit de fournir en quelques paragraphes un résumé de la réponse à la question posée, de la méthodologie employée et, éventuellement, des angles morts, problèmes non ou mal résolus.
- Introduction / État de la question / Revue de la littérature existante (9 000 à 12 000 signes). Cette partie s’efforce de cerner la question d’étude : quel en est le périmètre, que laisse-t-elle éventuellement de côté (explicitement ou non) ? Quel est son intérêt ? Quels sont ses enjeux ? La revue de littérature fait le point de manière critique sur les principaux apports précédents, de façon thématique (il ne doit pas s’agir d’une succession de résumés). Quelles voies ont-ils explorées ? Avec quelles méthodes ? Que valent leurs conclusions ? Quelles hypothèses de recherche peut-on formuler sur la base de ces éléments antérieurs ?
- Méthodologie de la recherche (4 000 à 6 000 signes). Cette partie méthodologique revient sur la démarche adoptée pendant l’année et sur les outils auxquels le binôme a eu recours (entretiens, observations, etc.), en détaillant l’approche et en donnant en particulier des informations sur le profil socio-économique des personnes enquêtées. Elle précise également si les recherches prévues ont été menées à bien, et si des difficultés ont été rencontrées.
- Éléments nouveaux, argumentaire et discussion (15 000 à 20 000 signes). Il s’agit du développement principal, exposant les résultats du travail empirique. Cette partie doit être organisée en sous-parties reprenant de façon claire ce que l’on peut tirer du travail de terrain. Ces résultats prolongent-ils ou contredisent-ils ceux des travaux précédents ? Quel est leur degré de fiabilité et de robustesse ? Faudrait-il envisager des recherches complémentaires, et dans quelle direction ?
- Bibliographie. Elle doit respecter les normes de présentation en vigueur et reprendre les sources mobilisées et citées dans le corps du mémoire. Une section spécifique sera consacrée aux prompts demandés à des logiciels d’IA.
- Annexes. De taille non quantifiée, ces annexes comprennent obligatoirement les retranscriptions d’entretiens ainsi qu’un récapitulatif du contenu de la bibliographie mobilisée, sous la forme d’un tableau à 8 colonnes (titre de l’article ou du livre, auteur(s), année, question traitée, méthodologie employée, terrain et/ou données mobilisés, thèse(s) critiquée(s), principaux résultats). Elles peuvent inclure d’autres éléments si nécessaire.
La note d’étape
Le but de la note d’étape est d’effectuer les premières phases de l’étude, à savoir établir un état des lieux sur la question posée et dégager la recherche à mener. Ses résultats pourront être repris, développés (et éventuellement modifiés) dans le rapport final. Elle devra respecter la structure suivante :
- État de la question / Revue critique de littérature (5 000 – 8 000 signes), partie auquel sera jointe une première version du tableau de bibliographie nécessaire pour l’annexe du mémoire (voir ci-dessus). À la fin de cette partie seront énoncées clairement les hypothèses de travail envisagées, qui devront être testées lors de l’étude.
- Méthodologie de la recherche envisagée (3 000 signes)
- Bibliographie provisoire, respectant les normes de présentation en vigueur.
La soutenance
Elle est effectuée en binôme (ou en trinôme) ; les deux membres du tandem doivent participer sur un pied d’égalité tant à la présentation des résultats elle-même qu’à la discussion qui la suit.
La présentation devra respecter un cadre professionnel. S’appuyant sur un diaporama, elle résume le contenu du travail et ses principales conclusions. Elle donne lieu à une évaluation propre (comptant pour 1/3 de la note globale du mémoire), portant sur la structuration de l’argumentation, le niveau d’expression orale, la qualité du diaporama (dont le soin orthographique et graphique), et les réponses aux questions.
Semestre 2
UE6 : Mutations du monde contemporain 2
 |
NOM
Statut Université |
Objectif pédagogique
Plan de cours
Modalités de contrôle des connaissances
Références bibliographiques
UE7 : Outils et Langues 2
 |
Kevin OLIVIER
Directeur général et consultant socio-économiste Cabinet AALTRA |
Objectif pédagogique
Ce cours vise à former les étudiant.es à la démarche qualitative, et en particulier aux techniques de l’entretien semi-directif. Il s’agit de maîtriser toutes les étapes de cette démarche, de la définition de la question à la restitution des résultats, en passant par la récolte et l’analyse des données. L’enjeu est aussi de comprendre la diversité des domaines dans lesquels les méthodes qualitatives peuvent être appliquées : recherche scientifique, études ou encore interventions de conseil auprès de différents types d’institutions. Pour ce faire, les étudiant.es sont amenés à concevoir et mettre en œuvre au cours du semestre une démarche d’enquête mobilisant les méthodes qualitatives.
A l’issue du cours, les étudiant.es seront capables de :
- Distinguer les méthodes qualitatives et quantitatives et reconnaître la pertinence de leur articulation ;
- Choisir entre différentes méthodes qualitatives en fonction d’une question d’étude ou de recherche ;
- Mettre en œuvre une démarche d’enquête qualitative, de l’analyse de la question à la restitution des résultats.
Plan de cours
- Les apports des méthodes qualitatives
- La préparation de l’enquête, les sources bibliographiques et leur apport à l’enquête
- L’entretien semi-directif
- L’observation
- L’analyse du matériau
- La restitution du matériau
- Rappels théoriques et atelier sur les travaux de mémoire
Modalités de contrôle des connaissances
Le cours est évalué en contrôle continu intégral.
- Présentation orale à partir d’un corpus de documents
50 % de la note finale, en groupe
En groupe de 2 à 4 personnes, les étudiant.es choisissent une étude produite à l’aide de méthodes qualitatives parmi celles proposées par le chargé de TD. Après avoir pris connaissance et échangé au sujet de cette étude, ils préparent collectivement une présentation de 20 à 30 minutes respectant le canevas général suivant :
- Sujet de l’étude ;
- Méthodologie utilisée et échantillon retenu ;
- Biais préalablement identifiés par les enquêteurs ;
- Analyse critique par les étudiant.es de la méthodologie utilisée, permettant de dégager ses apports et limites en lien avec le sujet de l’étude et ses conditions de réalisation ;
- Identification par les étudiant.es des possibilités d’enrichissement des résultats de l’étude ou d’approfondissement du sujet dans une étude ultérieure.
- Dossier de fin de semestre
50 % de la note finale
Les étudiant.es doivent remettre un dossier présentant la démarche méthodologique mise en œuvre dans le cadre de leur mémoire de recherche ou dans le cadre d’un sujet défini à l’avance. Ceux qui travaillent en binôme sur leur mémoire peuvent choisir de réaliser le dossier en binôme ; cela sera pris en compte dans la notation.
Le dossier est composé de :
- Une présentation du sujet et de la problématique choisis ;
- Une présentation de la méthodologie qui justifie les méthodes qualitatives mobilisées ;
- Une présentation du terrain d’enquête et/ou des caractéristiques de la population enquêtée ;
- Les grilles d’observation ou d’entretien utilisées ;
- 2-3 comptes-rendus d’observation ou retranscriptions d’entretien ;
- Une analyse du matériau recueilli sur le terrain
Les étudiants doivent venir à la séance d’atelier avec une version de travail de leur dossier comportant au minimum les quatre premiers éléments de la liste ci-dessus. Des points de pénalité seront appliqués sur la note finale du dossier si ce n’est pas fait.
Références bibliographiques
Beaud, S., Weber, F., 2010, Guide de l’enquête de terrain, Paris, La Découverte.
Jounin N., 2016, Voyage de classes, Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers, Paris, La Découverte.
Les cours de langue sont assurés par le département LANSAD (LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines).
Pour plus d’informations : https://u-paris.fr/eila/lansad/
 |
NOM
Statut Université |
Objectif pédagogique
Plan de cours
Modalités de contrôle des connaissances
Références bibliographiques
 |
Lise MARTIN Statut Université |
Objectif pédagogique
Plan de cours
Modalités de contrôle des connaissances
Références bibliographiques
À partir du mois de février, les étudiant.e.s sont invité.e.s à suivre différents ateliers destinés à les préparer dans leur recherche de contrat d’alternance : cadre juridique de l’alternance ; élaboration d’un CV et d’une lettre de motivation ; outils numériques pour la recherche d’alternance ; techniques d’entretien ; recherche d’alternance dans les métiers des études et du conseil ; organisation d’un job dating avec les structures d’accueil partenaires du master. Ces ateliers sont animés par des intervenants variés issus de l’APEC, du CFA Formasup, des partenaires du master et de l’Université Paris Cité. Le responsable du master assure également un suivi régulier jusqu’à la fin de l’année avec les étudiant.e.s pour les accompagner dans leur recherche d’alternance, en collaboration avec le service formation professionnelle de l’UFR GHES de l’université.
UE7 : Ouverture
1 cours à choisir parmi les cours suivants:
Les étudiants ont la possibilité de suivre une UE de Sport, d’engagement étudiant ou des formations dispensées par la Graduate School.
Alter’Actions est une association d’intérêt général qui vise à développer l’engagement, la coopération et l’action au service d’une société plus solidaire et durable. A travers ses programmes, elle met en lien le secteur de l’ESS, le monde étudiant et le monde des entreprises « classiques » afin de :
- soutenir des projets à forte contribution sociétale et environnementale,
- tout en engageant une nouvelle génération d’acteurs, formés et outillés pour créer le monde de demain.
L’association Alter’Actions est née en 2011 d’un constat :
- alors qu’il apporte des réponses innovantes et essentielles sur de très nombreux enjeux sociétaux prioritaires, le secteur de l’ESS souffre bien souvent de son manque de ressources et parfois de difficultés pour accéder à certaines compétences…
- les jeunes et les entreprises sont de plus en plus désireux.euses d’agir pour la société de demain, plus équitable et plus durable, et il.elle.s sont à la recherche de véritables leviers d’engagement…
C’est pour répondre à ces enjeux que Julien Fanon et Ahmat Faki, alors tous deux consultants chez Accenture, et Hubert Bonal, Délégué à l’égalité des chances d’HEC ont décidé de lancer Alter’Actions.
Aujourd’hui, l’association soutient et accompagne des associations, coopératives et entreprises sociales porteuses de projets à forte contribution sociétale. Nous mobilisons et engageons également une nouvelle génération d’acteurs.rices : des étudiant.es aux parcours divers et des professionnel.le.s d’entreprises partenaires.
Alter’Actions propose à des étudiant.e.s bénévoles, encadré.e.s par des professionnel.le.s, de réaliser des missions de conseil au bénéfice d’acteur.rice.s de l’ESS pour les accompagner pendant 4 mois dans leur développement et l’augmentation de leur impact.
Ces missions de conseil s’appuient sur un diagnostic précis des besoins des structures en amont par Alter’Actions et un suivi de chacun.e tout au long de la mission.
S’engager sur le programme :
- Des missions variées (étude d’impact, étude de faisabilité, développement partenariat…) auprès de structures engagées sur des thématiques diverses : environnement, éducation et égalité des chances, insertion …
- Une équipe pluridisciplinaire de 4 étudiant.e.s bénévoles (de la L3 au M2) aux formations et profils variés : commerce, sciences politiques, ingénierie, sciences sociales…
- Un encadrement par un binôme de professionnel.le.s
Pour en savoir plus : le site d’Alter’Actions
 |
Christine BRÉMOND Directrice du pôle Intercommunalités, Mairie Conseils |
Objectif pédagogique
- Permettre aux étudiants de se familiariser avec les finances des collectivités.
- Repérer les principaux acteurs, les outils, l’enchaînement des décisions à prendre au cours d’une année budgétaire.
- Comprendre les marges de manœuvre avec les recettes fiscales et financières et maîtriser la démarche de diagnostic financier.
Plan de cours
- Les différentes catégories de collectivités locales, bilan de l’avancée du bloc local avec la montée en puissance de l’intercommunalité à fiscalité propre.
- Les outils budgétaires, les acteurs, les délais, le contenu du budget : dépenses / recettes
- Les moyens financiers : la fiscalité locale : les quatre taxes leurs mécanismes de calcul et réformes en cours
- La réforme de la Taxe professionnelle et la péréquation mise en place notamment le FPIC
- Les dotations de l’État : la DGF et ses évolutions au niveau des masses financières et des modalités de calcul
- Le financement de l’investissement dont la situation de la dette des collectivités
- L’analyse financière : méthode et sélection des critères d’analyse.
Modalités de contrôle des connaissances
Contrôle continu : 50 %. Examen final : 50 %
Références bibliographiques
- Bidart M.-T., Moreau J.-C., 2006, La comptabilité des communes, Paris, Berger Levrault
- Brémond C., 1992 La solidarité financière intercommunale : partage ou mise en commun de la taxe professionnelle, Paris, Syros-Alternatives
- Robert F., 2009, Les finances locales, Paris, La documentation française
- Dosière R., Hoorens D., Anatharaman B., 2008, La communes et ses finances, Paris, Éditions Le Moniteur
- Montain Domenach J., Brémond C., 2007, Droit des collectivités locales, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble
- Duret J.-L., Hoorens D., Klopfer M., Laurent P., Phelep A., Taheri F., 2005, Ressources des collectivités locales, Paris, Dexia
 |
Thomas LAMARCHE Professeur d’économie, Université de Paris |
 |
Philippe MOATI Professeur d’économie, Université de Paris, L’ObSoCo |
Objectif pédagogique
Il s’agit d’une approche de la recherche, en lien à la posture de professionnel des études et du conseil qui est celle du Master CCESE, présentant différentes méthodes et démarches de recherche (avec une ouverture sur les méthodes institutionnalistes) et exposent les bases du travail de recherche : définition d’une problématique, à la confection d’une bibliographie, dépouillement et stockage de l’information… Une partie est basée sur la construction par les étudiants de problématique de recherche.
Plan de cours
-
-
- Séance 1. Qu’est-ce que faire de la recherche en économie ? (T Lamarche)
- Séance 2. La recherche d’information (Ph Moati)
- Séance 3. Un peu d’épistémologie. Eléments de méthodologie institutionnaliste. (T Lamarche)
- Séance 4. Le traitement de l’information. (Ph Moati)
- Séance 5. Retour sur les mémoires de recherche de M1. Bâtir une problématique. (T Lamarche)
• Chaque étudiant vient avec 2 diapos à partir de son mémoire de M1.
o 1. Problématique : la question de recherche
o 2. Le plan. Articulation des idées clés, et des sources (auteurs, références) - Séance 6. L’intérêt du détour par la recherche. (Ph Moati)
• Chaque étudiant vient avec un plan détaillé sur un sujet qu’il aura construit autour d’un thème donné en début d’année
Modalités de contrôle des connaissances
Moyenne des 2 notes associées aux travaux menés dans les séances 5 et 6.
Références bibliographiques
-
-
-
- Michel Beaud,L’art de la thèse, Paris, La Découverte, coll.Grands Repères,2006.
-
-
-
 |
Thibaud DEGUILHEM Maître de conférences en économie Université Paris Cité, |
Objectif pédagogique
Destiné aux étudiant-e-s de première année des Masters APE et MECI, cet enseignement offre un large panorama sur les instruments de l’analyse statistique et économétrique appliquée. Utilisant Rstudio et RMarkdown, ce cours propose aux étudiant-e-s de devenir autonome dans l’analyse quantitative en leur permettant de développer trois niveaux de compétences distincts : (i. savoir ) connaitre les outils statistiques (descriptifs, inférentiels et économétriques) adaptés afin d’apporter des réponses quantitatives à des questions spécifiques, ( ii. savoir-faire) appliquer ces outils et maîtriser les fonctionnalités essentielles du logiciel Rstudio pour produire une analyse complexe à partir d’un jeu de données, (iii. savoir-faire et savoir-être ) mettre en valeur des résultats quantitatifs
et travailler en équipe sur un rapport statistique.
Organisation
Trois parties structurent ce cours depuis le data management, jusqu’à l’introduction de l’économétrie de la causalité en passant par les statistiques descriptive et inférentielle. Tout au long du semestre, les étudiant-e-s auront à réaliser un rapport statistique en groupe sous RMarkdown. A partir d’un modèle fourni lors de la première séance, les étudiant-e-s seront accompagné-e-s par la mise à disposition de jeux de données originaux, la mise en place d’un forum dédié aux questions de script, de chunk ou de compilation (muut) et leur travail sera guidé par différents rendus intermédiaires.
Plan de cours
Partie I Data management, description et inférence
(a) Gestion de jeux de données et statistique descriptive
Fusion, suppression, modification de données, distributions, indicateurs de tendance centrale, de position et de dispersion
(b) Statistiques bivariée et inférentielle I
Tests de conformité, d’homogénéité, de normalité et d’association entre deux variables qualitatives
(c) Statistiques bivariée et inférentielle II
Analyse de la variance (ANOVA et tests post-hoc), corrélation, régression linéaire simple et principe d’estimation par les MCO
Partie II Économétrie appliquée I
(a) Régression linéaire multiple
Caractéristiques de l’estimateur MCO, qualité de l’ajustement, tests et fonctions non linéaires
(b) Régression avec variable dépendante binaire
Modèles LOGIT et PROBIT, estimateur EMV, qualité des ajustements et tests
(c) Modèle non-paramétrique et premiers pas vers l’étude de la causalité
Régressions quantile, qualité des ajustements, tests et corrélation vs. causalité
Partie III Économétrie appliquée II
(a) Modèles de médiation et en deux étapes
Correction du biais d’échantillonnage (2-Step Heckman et IMR) et variable indépendante médiatrice
(b) Mesurer un eet causal à partir de données non-expérimentales : Propensity Score Matching (PSM)
Principes des méthodes de matching, étapes du PSM, caractéristiques des estimations, qualité et tests
Modalités de contrôle des connaissances
Les étudiant-e-s sont évalué-e-s individuellement et collectivement en 50% CC et 50% ET.
– Évaluation en contrôle continu
Test individuel en ligne au terme de chaque partie (20%)
Rapport collectif (30%)
– Évaluation terminale
Examen final de 3h (50%)
Références bibliographiques
- Agresti, A. (2017). Statistical methods for the social sciences. Pearson, Boston, 5th edition.
- Cornillon, P.-A., Guyader, A., Husson, F., Jégou, N., Josse, J., Kloareg, M., Matzner-Lober, E., and Rouvière,
L. (2012). Statistiques avec R. Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 3rd edition. - Greene, W. (2011). Econométrie. Pearson, Paris, 7th edition.
- Leite, W. (2016). Practical propensity score methods using R. Sage Publications.
- Li, M. (2013). Using the Propensity Score Method to Estimate Causal Eects : A Review and Practical Guide.
Organizational Research Methods, 16(2) :188226. - MacKinnon, D. P., Fairchild, A. J., and Fritz, M. S. (2007). Mediation Analysis. Annual Review of Psychology,
58(1) :593. - Stock, J. H. and Watson, M. (2014). Principes d’économétrie. Pearson, Paris, 3rd edition.
Prérequis
Afin d’aborder ce cours dans de bonnes conditions, les étudiants doivent impérativement maîtriser diverses notions de bases en statistiques et en économétrie. Ils peuvent auto-évaluer leurs compétences en réalisant ce test en ligne.
En cas de résultats insuffisants, il est très vivement conseillé de procéder à une auto-formation, au moyen des ressources suivantes :
- Révisions. Statistiques descriptives (cours en ligne) : Décrivez et nettoyez votre jeu de données
- Révisions. Inférence statistique (cours en ligne) : Initiez vous à la statistique inférentielle
- Économétrie. Stock, J. H. et Watson, M. (2014). Principes d’économétrie, Pearson, Paris, chapitre 1 [disponible en ligne]. Manuel complet disponible à la BU des Grands Moulins : 330.4 STO.
UE8 : Transition écologique 2
 |
Petia KOLEVA Véronique BRESSON
Professeur d’économie Consultante |
Objectifs pédagogiques
Ce cours vise à donner aux étudiant·e·s une compréhension approfondie des fondements théoriques, institutionnels et pratiques de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et du développement durable (DD). Il propose une analyse critique des politiques et dispositifs mis en œuvre par les entreprises, en articulant enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
Les travaux dirigés complètent les cours magistraux par une approche appliquée, fondée sur des études de cas, des jeux de rôle et l’analyse de dispositifs concrets de gouvernance et de reporting ESG.
Compétences visées
- Comprendre les principaux modèles et référentiels de la RSE.
- Identifier les tensions entre discours, normes et pratiques.
- Se familiariser avec les outils et standards de reporting ESG.
- Analyser les risques et opportunités liés à la durabilité pour les entreprises.
- Développer une réflexion critique sur la gouvernance et la régulation des entreprises face aux enjeux environnementaux et sociaux.
Plan du cours magistral (12h)
Le CM s’articule autour de deux axes : la responsabilité sociétale des entreprises et la décroissance. Ces deux notions, bien qu’issues de traditions intellectuelles distinctes, interrogent les modes contemporains de production, de consommation et de régulation du capitalisme. La première partie retrace la définition, l’historique et les approches du concept de RSE avant d’examiner les modèles européen et anglo-saxon et leurs visions contrastées du rôle de l’entreprise. La seconde partie présente les principes clés de la décroissance et discute des indicateurs alternatifs comme l’indice de santé sociale. Elle aborde ensuite la remise en cause du capitalisme et du développement durable avant de s’intéresser aux limites et critiques formulées à l’égard des approches de la décroissance.
Travaux dirigés (12h) – 4 séances thématiques
- Gouvernance durable : rôle des conseils d’administration et des comités RSE/ESG
- Standards et outils de reporting (SASB, TCFD, CSRD/ESRS) vs notations ESG (MSCI, Sustainalytics, ISS ESG) et leurs impacts.
- Analyse des risques ESG pour une entreprise.
- Devoir de vigilance et chaîne de sous-traitance : traçabilité, audits et responsabilités.
Évaluation
Contrôle continu (50 %) / Examen final écrit (50 %).
Bibliographie indicative
Commission européenne (2023), Directive CSRD et normes ESRS.
Guy, Y., Henneguelle, A. et Puissant, E. (dir.) (2023). Grand manuel d’économie politique. Dunod. Partie 9. « Environnement et développement durable », p. 459-516.
Igalens, J. (2023). Splendeurs et misères de la RSE. EMS Éditions.
ISO 26000 : Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale.
Latouche, S. (2022). Le pari de la décroissance : penser et consommer autrement pour une révolution culturelle. Fayard/Pluriel.
TCFD (2017), Final Recommendations on Climate-related Financial Disclosures.
 |
Céline VACCHIANI-MARCUZZO Professeure de Géographie Université Paris Cité |
 |
Matthieu GIMAT Maître de conférences en Aménagement de l’espace, urbanisme Université Paris Cité |
Objectifs pédagogiques
Ce cours vise à analyser les dynamiques de développement dans leurs différentes dimensions en prenant en compte non seulement les démarches visant au développement économique, mais aussi celles visant au développement social et urbain. Il propose une approche critique de ces différentes notions, visant à rendre compte non seulement de la diversité des ressources qui peuvent être mobilisées dans le cadre de politiques de développement, mais aussi des indicateurs qui permettent d’en évaluer les effets. À partir d’études de cas concrets dans des pays des Nords comme des Suds globalisés et du passage en revue d’approches théoriques issues de travaux en géographie, économie, études urbaines et aménagement, les étudiantes et étudiants acquièrent une culture générale leur permettant d’analyser les ressources territoriales et les politiques visant à en tirer parti.
Plan de cours
- La notion de développement
- Développement économique : métropolisation et mondialisation ; l’économie présentielle et le développement des territoires ; l’innovation ; la financiarisation de l’économie et ses conséquences territoriales
- Développement social et urbain : la rénovation urbaine, la politique de la ville, la gestion urbaine et immobilière de proximité
Références bibliographiques
- Davezies, L., 2008, La République et ses territoires – La circulation invisible des richesses, Paris, La République des idées
- Talandier, M., 2023, Développement territorial, Paris, Armand Colin.
- Gilbert, P., 2024, Quartiers populaires. Défaire le mythe du ghetto, Paris, Amsterdam.
 |
Alice GISSINGER
Chercheuse-Analyste, le BASIC (www.basic.coop)
|
Objectif pédagogique
Dans ce cours, les étudiants découvriront les mutations sectorielles dans le domaine de l’agroécologie, abordée ici comme un ensemble de pratiques agricoles, de modèles économiques et de mouvements sociopolitiques qui soutiennent une vision plus durable des systèmes agroalimentaires contemporains. Sous l’angle de la durabilité socioéconomique et écologique, nous aborderons dans l’ordre : le lien entre durabilité et agroécologie ; l’agroécologie dans ses multiples facettes ; l’érosion de la biodiversité et son lien avec les systèmes alimentaires en place ; les principes socioéconomiques, dont l’équité et l’inclusivité, dans les chaînes de valeur agroalimentaires ; et le rôle plus ou moins favorable joué par le secteur public, le secteur privé, et la société civile et les individus dans la gouvernance de l’agroécologie. Les étudiants jouent un rôle actif dans le cours à travers des discussions en classe d’articles scientifiques (1 article par semaine) ainsi qu’à travers une présentation, en petits groupes, d’études de cas en lien avec le thème de chaque séance.
À la fin du cours, les étudiants auront acquis des connaissances sur les concepts suivants : développement durable ; agroécologie ; agriculture « conventionnelle », biologique et agroécologique ; biodiversité ; systèmes alimentaires ; équité dans les systèmes alimentaires ; commerce équitable ; et rôle des organisations internationales, du secteur privé, du secteur public et de la société civile dans la gouvernance des systèmes agroalimentaires.
Plan de cours
- La durabilité : toile de fond de l’agroécologie
- Agroécologie : introduction socio-historique et politique
- Agroécologie : fondements agronomiques
- De la difficulté de sortir des pesticides
- Biodiversité : état des lieux et gouvernance
- Principes socioéconomiques dans les chaînes de valeur agroalimentaires
- La Politique Agricole Commune, un bilan contrasté
- Limites et échecs des actions du secteur public
- Le secteur privé et la transition agroécologique
- La société civile et les citoyens comme moteurs du changement
- Agroécologie pour et dans les pays du Sud
- Séance intégrative collective : Qu’avons-nous appris ?
Modalités de contrôle des connaissances
- Contrôle continu / Participation active pendant les séances : 30%
- Etude de cas (en groupe avec ~4 autres étudiants) : 30%
- Examen de fin de cours, sur table (semaine du 18 mai) : 40%
Références bibliographiques
- Altieri, Miguel. “Agroecology, Small Farms, and Food Sovereignty”, 2010; https://tinyurl.com/yplk7hmw
- Clapp, Jennifer. “Explaining Growing Glyphosate Use: The Political Economy of Herbicide-Dependent Agriculture.” Global Environmental Change 67 (March 2021): 102239. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102239
- “The IPBES Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia.” 24 March 2018. https://doi.org/10.5281/zenodo.3237429.
- Cuadros-Casanova et al., “Opportunities and Challenges for Common Agricultural Policy Reform to Support the European Green Deal.” Conservation Biology 37, no. 3 (2023): e14052. https://doi.org/10.1111/cobi.14052
- Chapitre 1 de Raworth, Kate. Doughnut Economics: Seven Ways to Think like a 21st Century Economist. White River Junction, Vermont : Chelsea Green Publishing, 2017.
- FRANÇAIS (traduction Deepl, consulter l’anglais pour les figures)
- ANGLAIS
- Le livre entier en anglais : https://tinyurl.com/237cp4az
UE9 : Itinéraire Marketing
Uniquement pour les étudiants de l’option MK
 |
Erwan BARBIER |
Objectifs pédagogiques
Conjonction de théorie, d’exemples, d’exercices pendant le cours en sous-groupe et de lectures ou recherches entre 2 cours.
Plan du cours
Modalité de contrôle des connaissances
Contrôle en fin d’année
Bibliographie de base
EN FRANCAIS
MERCATOR- Lendrevir, Lévy, Lindon – Editions Dunod – 55 euros
o http://www.mercator-publicitor.fr/Lexique-du-marketing-livre-Mercator-Dunod-Editeur
KOTLER Philip & DUBOIS Bernard Marketing management, Publi-union
VANDERCAMMEN Marc Recherche marketing, De Boeck Université
MARKETING LES CONCEPTS CLEFS – S. Martin & J.Pierre Védrine – Les éditions des organisations
o http://cours-gestion.com/principaux-concepts-cles-marketing/
Naomi Klein – No Logo, « la tyrannie des marques » –( 2001) Actes Sud – 24,60€
Datavision « mille et une informations essentielles et dérisoires à comprendre en un clin d’œil »- DavidMcCandless – Ed. Robert Laffont – 23€ ( ed 2011) à source d’inspiration pour présenter des données et faire passer des messages
Petit traité de manipulations à l’intention des honnêtes gens – Robert Vincent Joule & Jean Léon Beauvois – 1987-
L’art de la guerre – Sun Tsu – en pdf sur le net à Sur la stratégie
Mythologies – Roland Barthes – Sémiologue – Version brochée avec photos se trouve parfois à 25€ – Version poche sans photo à Sur la marque
Le questionnaire dans l’enquête psycho-sociale- Roger Mucchielli – Les éditions ESF
PÉRIODIQUES
La revue française de Marketing – Adetem –
o http://www.adetem.org/xwiki/bin/view/NBAdetem/Revue
Marketing Magazine – mensuel
60 Millions de consommateurs
WEB
Quand vous allez chercher des informations sur le marketing, à titre de formation, choisir les grandes écoles de commerce ( HEC, ESCP, etc.) attention aux individuels inconnus …. Ou connus d’ailleurs
Vous abonnez à des newsletter ou /et aller visiter leur site :
Credoc, ( analyses France) Ipsos ( institut d’études marketing internationales), TNS Sofres, GfK,
McKinsey , BCG France et groupe esomar.org à code de déontologie ( diffusé avec le cours N°1)
Consumer protection ( UK) http://www.covermagazine.co.uk/cover/feature/2150104/consumer-protection
USA https://publications.usa.gov/USAPubs.php?NavCode=XA&CatID=12
ARTICLES ET EXTRAITS
Le marketing est-il manipulatoire, idéologique et immoral ? (source : Mercator 2009)
 |
Christophe PIAR Enseignant-chercheur |
Objectifs pédagogiques
Ce cours explore les mécanismes de formation et de changement des opinions des citoyens, ainsi que les questions méthodologiques posées par la mesure de ces opinions. Il présente ainsi les grands modèles explicatifs développés dans la recherche française et internationale, depuis les analyses (parfois qualifiées de « déterministes ») mettant l’accent sur les variables dites « lourdes » (catégorie sociale, religion…) jusqu’aux approches inspirées de la psychologie cognitive, qui insistent sur les processus de raisonnement individuel. Le cours initie enfin les étudiants aux méthodes utilisées par les instituts de sondage pour quantifier les opinions des citoyens, en soulignant leurs atouts mais aussi leurs faiblesses.
Plan du cours
I. L’influence des variables de long terme sur les opinions des citoyens
A. Le modèle de la géographie humaine
B. Le modèle du traumatisme historique
C. Le modèle de Columbia et le rôle des appartenances sociales
D. Le paradigme de Michigan et la transmission familiale des opinions
II. L’influence des variables de court terme sur les opinions des citoyens
A. L’influence de l’image des acteurs politiques
B. L’impact de la conjoncture économique
C. Le rôle des enjeux
III. Les apports de la psychologie cognitive à la science des opinions
A. Les raccourcis cognitifs et le mécanisme de l’inférence
B. Une rationalité à faible information ?
C. Le rôle de l’émotion dans la formation des opinions
IV. Les effets des médias sur les opinions des citoyens
A. La persuasion directe
B. L’effet d’agenda
C. L’effet d’amorçage
D. L’effet de cadrage
V. La mesure quantitative des opinions : les sondages d’opinion
A. L’institutionnalisation des sondages d’opinion aux Etats-Unis et en France
B. Le questionnaire
C. La constitution de l’échantillon
D. Les modes de passation (face à face, téléphone, internet)
E. Les redressements
Références bibliographiques
BON, Frédéric, Les sondages peuvent-ils se tromper ?, Calmann-Lévy, 1974.
BRÉCHON, Pierre, Comportements et attitudes politiques, PUG, 2006.
CAYROL, Roland, Opinion, sondages et démocratie, Presses de Sciences Po, 2011.
DARGENT, Claude, Sociologie des opinions, Armand Colin, 2011.
DONSBACH, Wolfgang, TRAUGOTT, Michael, The Sage Handbook of Public Opinion Research, Sage, 2008.
EDWARDS III, George, JACOBS, Lawrence, SHAPIRO, Robert, The Oxford Handbook of American Public Opinion and the Media, Oxford University Press, 2011.
LEHINGUE Patrick, Subunda. Coup de sonde dans l’océan des sondages, Ed. du Croquant, 2007.
MAYER, Nonna, Sociologie des comportements politiques, Armand Colin, 2010.
PIAR, Christophe, Comment se jouent les élections. Télévision et persuasion en campagne électorale, INA Editions, 2012.
RIVIERE, Emmanuel, HUBE, Nicolas, Faut-il croire les sondages ?, Prométhée, 2008.
Modalités de contrôle des connaissances
50 % contrôle continu (dont 25 % devoir sur table et 25 % note d’analyse) et 50 % examen final.
UE9 : Itinéraire Organisation, Emploi, Travail
Uniquement pour les étudiants de l’option OET
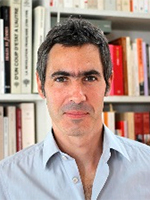 |
Antoine REBERIOUX Professeur d’économie Université de Paris |
Objectifs pédagogiques
Le cours s’intéresse à l’évolution, depuis quatre décennies, des pratiques en matière de gestion des ressources humaines et de dialogue social au sein des entreprises. Au niveau théorique, le cours s’appuie sur l’analyse institutionnaliste et la microéconomie. Au niveau empirique, les tendances sont notamment analysées à partir des données d’enquête (REPONSE, enquête sur la structure des salaires, etc.) les plus récentes. Les thèmes traités sont les suivants : les relations professionnelles, l’organisation du travail, les salaires et la mobilité.
Plan du cours
1. Introduction : les marchés internes du travail et le modèle fordiste2. Relations professionnelles et négociation collective
2.1. Les institutions représentatives du personnel en France
2.2. Les différents niveaux de négociations
2.3. Syndicats salariés et patronaux : les acteurs du système français3. Organisation du travail et changements technologiques
3.1. La dynamique des nouvelles formes d’organisation du travail
3.2. La complémentarité avec les TIC
3.3. Productivité et progrès technique biaisé4. La rémunération du travail
4.1. Le niveau des salaires : détermination et évolution
4.2. La diversification des pratiques5. Mobilité des salariés et stabilité de l’emploi
5.1. Evolution des mobilités sur le marché du travail
5.2. La mobilité vue au niveau de l’entreprise
5.3. CDD et intérim : des logiques différentes
Conclusion : les marchés internes aujourd’hui
Modalités de contrôle des connaissances
Contrôle continu (exposé) + examen final
Bibliographie de base
Stankiewicz, F. et Léné, A. (2011), L’économie des ressources humaines, La Découverte, col. Repères, Paris, 2011.
Site de la DARES (Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques ; Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social), http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/
 |
Olivier BLANDIN PAST, Université de Paris |
Objectif pédagogique
La notion de performance est utilisée très largement par les entreprises pour qualifier, d’une part, les résultats de leur activité ; d’autre part, les ressources qu’elles mobilisent pour obtenir ces résultats. Le cours s’attachera à expliciter le concept de performance économique, d’indiquer les principaux éléments du modèle industriel de la performance et du modèle servicielle de la performance. Il s’agira alors de souligner l’importance de prendre en compte la centralité du travail, le rôle des ressources immatériels et les dispositifs à même de renforcer la performance. Le cours mobilisera des cadres théoriques de l’économie, de l’ergonomie, de la psychodynamique du travail.
Plan de cours
Introduction : retour sur les concepts de motivation, satisfaction, implication
Partie 1 : Le modèle industriel de la performance
- Les trois registres: qualité, productivité et rentabilité
- Les principaux leviers et déterminants de la productivité
Partie 2 : Les activités de service
- Le triangle des services
- La notion d’output
- Les configurations productives des services
- Le processus d’arbitrage
Partie 3 : Le modèle serviciel de la performance
- L’articulation des registres de la performance
- La prise en compte de deux registres complémentaires (effets de réflexivité et externalité) et la tension entre les différents registres
- Le travail comme ressource
- L’enjeu de la coopération et la question du management
- Les principaux leviers
Modalités d’évaluation
Examen final : Rendu d’un devoir écrit (étude de cas) et présentation orale.
Références bibliographiques
- Jean Gadrey, 1996, « Services, la productivité en question », Desclée de Brouwer, Paris
- Christian du Tertre, 1999, « Activités immatérielles, subjectivité, productivité », Performances humaines et techniques, hors-série, sept.
- Christian du Tertre et Olivier Blandin, 2001, « Performance des activités de service. Le cas de La Poste en zones urbaines sensibles », Collection recherche de La Poste.
- O. Blandin, 2013. « Travail, subjectivité et activités de service » in Economie, subjectivité et travail. Revue Travailler, n° 29, pp. 65-79.
- F. Hubault, 2013. « Le travail de management », in Economie, subjectivité et travail. Revue Travailler, n°29, pp 81-96.
UE10 : Mémoire d’étude
Réalisé en binôme (ou en trinôme), ce mémoire d’étude s’efforce de répondre à une problématique en mobilisant des données essentiellement qualitatives, dans l’esprit d’une étude socio-économique professionnelle. Tout au long de l’année, le travail sera encadré par Anaïs Henneguelle. Ce cours nécessite une quantité importante de travail personnel entre chaque séance.
Sujet
Le mémoire d’étude doit porter sur une situation de travail particulière (qu’il s’agisse d’un métier particulier, d’une branche, de conditions de travail ou d’emploi spécifiques, etc.), choisie par le binôme d’étudiant·es. Il doit inclure une perspective comparative et un focus spécifique sur les questions écologiques (pratiques, représentations, intégration au travail).
Il s’agit, à partir d’une question clairement formulée au sujet de cette situation de travail :
- De dresser un état des lieux : quelles réponses ont été apportées jusque-là ? Quelles hypothèses de travail peut-on formuler sur cette base ?
- De mobiliser des données (essentiellement qualitatives) susceptibles d’apporter des éléments nouveaux.
- De montrer en quoi ces éléments confirment, complètent, ou réfutent les (différentes) réponses traditionnellement proposées.
L’IA générative donnant aujourd’hui de très bons résultats, il ne s’agira pas d’évaluer en priorité le fond du propos, mais plutôt des compétences très spécifiques, aux premiers rangs desquelles figurent la capacité à synthétiser, à présenter des résultats et à analyser des données qualitatives issues d’un terrain de recherche.
Rendus
Les sujets donnent lieu :
- Au rendu d’une note d’étape le jeudi 18 décembre 2025 (tout retard sera pénalisé d’un point par jour entamé).
- au rendu du mémoire lui-même, obligatoire pour la session 1, lundi 4 mai 2026 (idem).
- à une soutenance publique entre le mardi 19 et le vendredi 22 mai 2026 comportant une présentation de 15mn, suivie d’échanges avec le jury (pour une durée totale de 30
minutes).
Dans une perspective d’économie d’échelle, les entretiens menés pour le mémoire d’étude devront également servir pour l’évaluation du cours de Méthodes qualitatives (enquêtes et entretiens) du semestre 8.
Format
Le mémoire devra répondre à la forme suivante (la taille des différentes parties devra
impérativement être respectée) :
- Résumé des conclusions (2 000 signes). Il s’agit de fournir en quelques paragraphes un résumé de la réponse à la question posée, de la méthodologie employée et, éventuellement, des angles morts, problèmes non ou mal résolus.
- Introduction / État de la question / Revue de la littérature existante (9 000 à 12 000 signes). Cette partie s’efforce de cerner la question d’étude : quel en est le périmètre, que laisse-t-elle éventuellement de côté (explicitement ou non) ? Quel est son intérêt ? Quels sont ses enjeux ? La revue de littérature fait le point de manière critique sur les principaux apports précédents, de façon thématique (il ne doit pas s’agir d’une succession de résumés). Quelles voies ont-ils explorées ? Avec quelles méthodes ? Que valent leurs conclusions ? Quelles hypothèses de recherche peut-on formuler sur la base de ces éléments antérieurs ?
- Méthodologie de la recherche (4 000 à 6 000 signes). Cette partie méthodologique revient sur la démarche adoptée pendant l’année et sur les outils auxquels le binôme a eu recours (entretiens, observations, etc.), en détaillant l’approche et en donnant en particulier des informations sur le profil socio-économique des personnes enquêtées. Elle précise également si les recherches prévues ont été menées à bien, et si des difficultés ont été rencontrées.
- Éléments nouveaux, argumentaire et discussion (15 000 à 20 000 signes). Il s’agit du développement principal, exposant les résultats du travail empirique. Cette partie doit être organisée en sous-parties reprenant de façon claire ce que l’on peut tirer du travail de terrain. Ces résultats prolongent-ils ou contredisent-ils ceux des travaux précédents ? Quel est leur degré de fiabilité et de robustesse ? Faudrait-il envisager des recherches complémentaires, et dans quelle direction ?
- Bibliographie. Elle doit respecter les normes de présentation en vigueur et reprendre les sources mobilisées et citées dans le corps du mémoire. Une section spécifique sera consacrée aux prompts demandés à des logiciels d’IA.
- Annexes. De taille non quantifiée, ces annexes comprennent obligatoirement les retranscriptions d’entretiens ainsi qu’un récapitulatif du contenu de la bibliographie mobilisée, sous la forme d’un tableau à 8 colonnes (titre de l’article ou du livre, auteur(s), année, question traitée, méthodologie employée, terrain et/ou données mobilisés, thèse(s) critiquée(s), principaux résultats). Elles peuvent inclure d’autres éléments si nécessaire.
La note d’étape
Le but de la note d’étape est d’effectuer les premières phases de l’étude, à savoir établir un état des lieux sur la question posée et dégager la recherche à mener. Ses résultats pourront être repris, développés (et éventuellement modifiés) dans le rapport final. Elle devra respecter la structure suivante :
- État de la question / Revue critique de littérature (5 000 – 8 000 signes), partie auquel sera jointe une première version du tableau de bibliographie nécessaire pour l’annexe du mémoire (voir ci-dessus). À la fin de cette partie seront énoncées clairement les hypothèses de travail envisagées, qui devront être testées lors de l’étude.
- Méthodologie de la recherche envisagée (3 000 signes)
- Bibliographie provisoire, respectant les normes de présentation en vigueur.
La soutenance
Elle est effectuée en binôme (ou en trinôme) ; les deux membres du tandem doivent participer sur un pied d’égalité tant à la présentation des résultats elle-même qu’à la discussion qui la suit.
La présentation devra respecter un cadre professionnel. S’appuyant sur un diaporama, elle résume le contenu du travail et ses principales conclusions. Elle donne lieu à une évaluation propre (comptant pour 1/3 de la note globale du mémoire), portant sur la structuration de l’argumentation, le niveau d’expression orale, la qualité du diaporama (dont le soin orthographique et graphique), et les réponses aux questions.
