Présentation
L’année de M2 s’effectue en alternance. Les missions effectuées par les étudiants dans leurs structures d’accueil sont variées, en fonction de l’option suivie, mais aussi au sein même de ces dernières. Certaines présentent une forte dimension technique, d’autres demandent la réalisation d’études de marchés, de dynamiques territoriales ou de prospective, tandis que des missions demandent la mise en œuvre de compétences opérationnelles en termes de gestion de projet, de conseil, de conduite du changement, etc… À l’université, les étudiants renforcent leur maîtrise des techniques quantitatives et qualitatives, leur formation dans l’accompagnement des organisations au changement en général et à la transition écologique en particulier, tout en approfondissant leurs compétences dans une des deux options (Marketing (MK) ou Organisation, emploi, travail (OET)). Les cours, suivis sur un rythme intensif les jeudi et vendredi s’accompagnent de projets à réaliser seul ou en binômes, qui visent à consolider les apprentissages réalisés par les étudiants durant leurs enseignements et leurs expériences au sein des structures d’accueil de leur alternance.
Télécharger la nouvelle maquette des enseignements de M2 (septembre 2025)
Semestre 1
Sauf mention contraire, les enseignements présentés dans chacune des UE sont obligatoires.
UE 1 — Techniques d’expression et de communication
 |
Emmanuelle PAQUET Comédienne, En AcT et enseignante, ESIEE Paris |
Objectif pédagogique
L’enseignement vise à acquérir des outils efficaces pour transmettre à l’oral avec aisance et naturel : identifier sa voix, maitriser son souffle ; ressentir sa posture ; gérer le stress, se préparer physiquement ; développer le regard et l’écoute ; se préparer mentalement ; prendre conscience de soi face à l’autre ; gérer l’espace ; faire face à l’imprévu lors du discours ; rester réactif et créatif face à la déstabilisation ; se faire confiance.
Plan de cours
Ce cours aborde les principaux aspects de la communication orale à travers les techniques du théâtre, avec un entraînement pratique prépondérant.
Le cours s’organise autour de trois axes :
- Le corps : Jeux d’écoute et d’observation ; Respiration, relaxation, utilisation de l’énergie ; Posture, prise de conscience de soi devant le public.
- La voix : Travail sur la colonne d’air, la respiration, le souffle ; L’articulation ; L’adresse au public.
- Le message : Faire passer le message, associer le corps et la voix.
Modalités de contrôle des connaissances
Contrôle continu à 100 %. La notation ne se fera pas sur un résultat mais sur l’engagement dans le travail, c’est-à-dire à la fois sur la présence aux cours et les efforts fournis pour suivre les consignes. Il n’est pas prévu d’épreuve de rattrapage en conséquence de cette modalité d’évaluation.
Références bibliographiques
- Ysabelle Cordeil-Le Millin, S’exprimer en public avec les techniques des acteursS, Dunod, 2015.
- Gérard Quentin, SEnseigner avec aisance grâce au théâtreS, Chronique sociale, 2004.
 |
NOM
Statut Université |
Objectif pédagogique
Plan de cours
Modalités de contrôle des connaissances
Références bibliographiques
UE 2 — Techniques qualitatives et quantitatives
 |
Sébastien DUBOIS
Directeur des études – SUPPER by Square Management |
Objectif pédagogique
Se familiariser avec les outils méthodologiques propres aux études qualitatives, appliquées dans un contexte professionnel (analyse d’une commande, construction d’une méthodologie, mobilisation des différents outils, traitement de données, analyse croisée, élaboration de conclusions …).
L’objectif principal de cet enseignement consiste à transmettre aux étudiants des outils pour construire et mener à bien une enquête qualitative, en maîtrisant le choix des approches et leur utilisation (guides d’entretien, grilles d’observation, trame d’animation de groupes …). L’enseignement permettra également de mobiliser concrètement les méthodes qualitatives à travers des mises en situation dans différentes configurations et champs d’intervention.
Plan de cours
Séance 1. Introduction, le métier de chargé.e d’étude et ses outils
Séance 2. L’entretien individuel et le récit de vie
Séance 3. L’observation (participante et non participante)
Séance 4. L’animation de groupes et d’ateliers participatifs
Séance 5. Le traitement de données et l’élaboration de conclusions
Séance 6. Examen
Modalités de contrôle des connaissances
Mise en situation à travers un cas pratique : commande fictive appelant le déploiement d’une enquête qualitative. Il sera demandé aux étudiants de construire leur méthodologie d’enquête, en justifiant le choix des outils utilisés pour recueillir les données.
Références bibliographiques
- Beaud Stéphane, Weber Florence, Guide l’enquête de terrain, La Découverte (Guide. Repères), 1997
- Bourdieu Pierre, Chamboredon Jean-Claude, Passeron Jean Clause, Le métier de sociologue, Mouton-Bordas, 1968.
- Dumez, Hervé. Méthodologie de la recherche qualitative. Les questions clés de la démarche compréhensive. Vuibert, 2016
- Bardin Laurent. L’analyse de contenus, PUF, 1998

Objectif pédagogique
Plan de cours
Modalités d’évaluation
Références bibliographiques
 |
Grégory CARET Directeur de l’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir |
Objectif pédagogique
L’objectif du cours est d’ouvrir les étudiants à la conception d’enquêtes quantitatives. Il se développe autour de trois thèmes principaux :
- Le rappel de la finalité de l’enquête quantitative ;
- L’échantillonnage : ses principes et ses techniques ;
- La conception du questionnaire d’enquête.
Le cours est ponctué d’exemples réels et d’exercices pratiques en petits groupes pour permettre aux étudiants d’assimiler rapidement le cours.
Plan de cours
- La conception générale des enquêtes quantitatives : objectifs et processus
- L’échantillonnage : pourquoi échantillonner et comment ? Détermination de la taille d’échantillon, représentativité et mise en place de quotas
- Le questionnaire : sa dynamique, les questions, les écueils à éviter, les contrexemples !
Modalités de contrôle des connaissances
Réalisation d’un questionnaire en groupe et examen final.
Références bibliographiques
- Pierre Bréchon, Enquêtes qualitatives, enquêtes quantitatives, PUG, 2011
- Jean-Luc Giannelloni, Eric Vernette, Etudes de marché, Vuibert, 2019
- Pascal Ardilly, Les techniques de sondage, Technip, 2006
- François De Singly, L’enquête et ses méthodes. Le questionnaire, Armand Colin, coll. « 128 », 2012
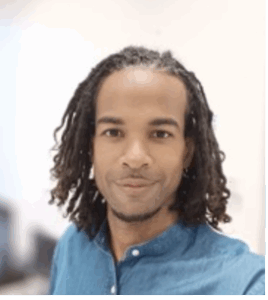 |
Nicolas SIOUNANDAN Chercheur en économie (Ladyss – CNRS) |
Objectifs pédagogiques
Ancré thématiquement sur le champ de l’emploi, ce cours initie les étudiants aux principaux outils quantitatifs mobilisés par les chargés d’études socioéconomiques.
Après une réflexion critique sur l’usage des données chiffrées, le cours présente les différents types de données ainsi que les techniques pour les décrire et en étudier les relations. Dans une perspective professionnalisante, les étudiants seront formés à l’interprétation des résultats, ainsi qu’à leur mise en forme et à leur restitution.
Pour traiter les données, les étudiants s’initieront à l’usage des logiciels Microsoft Excel et SAS tout en découvrant comment s’appuyer sur l’intelligence artificielle générative pour gagner en autonomie lorsqu’ils rencontrent des difficultés techniques.
Plan de cours
- Adopter une posture critique face aux chiffres
- Appréhender une base de données
- Distinguer les types de variables
- Mobiliser les techniques d’analyse
- Communiquer les résultats
Modalités de contrôle des connaissances
Réalisation d’une étude à partir des données quantitatives d’une enquête de l’INSEE en rapport avec l’emploi.
Références bibliographiques
Ces ouvrages sont disponibles en version numérique sur l’ENT
* Henneguelle, A., & Jatteau Arthur. (2021). Sociologie de la quantification. La Découverte.
* Martin, O. (2022). L’analyse quantitative des données. Armand Colin.
 |
Etienne ROUSSEL Consultant en stratégie, Wakuroo (traitement et analyse des données d’enquêtes et de sondages) |
Objectif pédagogique
L’objectif du cours est d’initier les étudiants aux principales méthodes d’analyse de données quantitatives, appliquées sur des données réelles, à l’aide du logiciel SPSS. L’enseignement inclut un rappel des concepts statistiques de base et des principes d’utilisation du logiciel SPSS et se concentre ensuite sur l’application à des cas concrets (sous forme de TD), permettant aux étudiants de réaliser et d’interpréter les résultats des analyses statistiques usuelles (statistiques descriptives et inférentielles, régression linéaire et logistique, analyses factorielles et classification).
Plan de cours
- Définition des principaux concepts liés aux enquêtes quantitatives
- Introduction au logiciel SPSS
- Manipulation des données (Import et export, création et transformation de variables, fusion et filtrage de tables, redressement d’échantillon)
- Statistiques descriptives (tableaux à plat et croisés, principaux indicateurs de tendance centrale et de dispersion, corrélations)
- Eléments de statistiques inférentielles (théorie des tests, comparaison de moyennes et de proportions, Chi²)
- Introduction à la régression linéaire et à la régression logistique
- Analyses Factorielles et Classification
Modalités de contrôle des connaissances
Contrôle continu et projet individuel réalisé tout au long de l’année. Traitement et analyse d’un fichier de données réelles (fichiers INSEE, Open Data) à l’aide du logiciel SPSS, permettant de mettre en œuvre les acquis du cours. Le travail réalisé est suivi d’une présentation écrite et orale des résultats.
Références bibliographiques
- Pascal Ardilly, Les techniques de sondage, Technip 2006
- Documentation de SPSS, accessible à l’URL : support.SPSS.com/documentation
- Olivier Decourt, SPSS L’essentiel, Dunod, 2011
- Bernard Py, Statistique descriptive : Nouvelle méthode pour bien comprendre et réussir, Economica 2007
- Stéphane Tuffery, Data mining et statistique décisionnelle, Technip, 2012
 |
Véronique BRESSON
ESG Value
|
Objectif pédagogique
L’objectif de cet enseignement est de permettre aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires pour identifier, mesurer et interpréter les principaux indicateurs écologiques, tels que le bilan carbone, l’analyse du cycle de vie (ACV) ou les indicateurs de biodiversité, afin d’évaluer l’impact des activités humaines et économiques sur les écosystèmes. Cette compréhension leur permettra de mobiliser ces outils pour orienter les décisions stratégiques, concevoir des plans de réduction d’impact et contribuer à la mise en place de modèles économiques plus durables. Ils intégreront que les indicateurs écologiques sont des leviers indispensables pour piloter la performance environnementale, soutenir les politiques de résilience à long terme et favoriser la transition vers une économie bas carbone et respectueuse du vivant.
Plan de cours
- Concepts et cadres des indicateurs écologiques
- Comprendre le rôle des indicateurs dans la transition environnementale.
- Découvrir les cadres méthodologiques : scientifique, institutionnel, réglementaire.
- Savoir construire un indicateur : périmètre, données, unités de mesure.
- Expérimenter la collecte et l’interprétation des données via un cas pratique.
- Principe de l’ACV et bilan carbone
- Apprendre les étapes d’une Analyse du Cycle de Vie (ACV).
- Connaître les scopes 1, 2, 3 et la notion de Scope 4 du bilan carbone.
- Comprendre les impacts environnementaux : acidification, eutrophisation, épuisement des ressources.
- Hiérarchiser les leviers d’action pour la réduction des émissions et la transition bas carbone.
- Mesurer l’impact environnemental : ACV pas à pas
- Définir le périmètre fonctionnel et identifier les flux.
- Quantifier les impacts à chaque phase du cycle de vie.
- Réaliser un cas pratique sur un produit avec bases de données ADEME/Empreinte.
- Prioriser les actions de réduction et éclairer les choix d’écoconception.
- Biodiversité et indicateurs écologiques
- Identifier les indicateurs clés liés à la biodiversité.
- Comprendre leur complémentarité avec les indicateurs carbone.
- Utiliser des bases de données pour des analyses concrètes.
- Illustrer l’importance des indicateurs pour certains secteurs via un cas pratique.
- Stratégie de réduction et résilience
- Relier indicateurs écologiques et outils de décision stratégique : plans d’action, priorités, communication RSE.
- Suivre la performance environnementale dans la durée.
- Déployer stratégies de décarbonation et réduction des impacts biodiversité.
- Intégrer les indicateurs dans la gouvernance en conformité avec CSRD, taxonomie européenne, et objectifs de neutralité carbone.
Modalités de contrôle des connaissances
U examen écrit intermédiaire sur les notions clés d’indicateurs écologiques (QCM) (50%) un examen écrit (50%) comprenant une partie théorique visant à vérifier la compréhension des indicateurs écologiques et leur complémentarité avec les indicateurs carbone et biodiversité, et une partie pratique où les étudiants analysent des documents pour proposer un plan d’action stratégique et réaliste. Elle mesure à la fois la maîtrise des concepts, la capacité d’analyse et l’application des indicateurs dans la gouvernance et la stratégie RSE.
Références bibliographiques
- Olivier Jolliet, Myriam saadé-Sbeih, Pierre Crettaz, Nicole Jolliet-Gavin, Shanna Shaked, Analyse du cycle de vie : comprendre et réaliser un écobilan, PU polytechnique, 4ème édition, 2024.
- Frédéric P. Miller, Agnes F. Vandome, Josh McBrewster, Indicateur Environnmental, Alphascript, 2010.
- ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). Guide méthodologique pour la réalisation de Bilan Carbone® lien : ici
- Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, Convention sur la Diversité Biologique (CDB), Protocole de Nagoya lien : ici
UE 3 — Dynamique stratégique et accompagnement du changement
 |
Yves Cornu Senior Advisor Deloitte Consulting |
Objectif pédagogique
Initier les étudiants à la démarche stratégique et à la place et au rôle du diagnostic dans cette démarche afin de leur offrir de nouveaux outils d’analyse et d’intervention dans le fonctionnement des entreprises.
Dans un premier temps, former les étudiants a de nouveau outils de questionnement et d’action. Dans un second temps, sur la base d’études de cas et de retours d’expérience, partager une pratique professionnelle (la pratique du diagnostic stratégique en tant que consultant) afin d’évoquer les démarches stratégiques actuelles dans le monde des entreprises, les modalités du recours aux consultants, et les conditions d’exercice du métier de consultant. L’ambition est d’aider les étudiants à mieux appréhender leur futur environnement professionnel et ses modalités de fonctionnement. .
Plan de cours
Partie 1 : Mise en contexte : vision panoramique des démarches stratégiques
Partie 2 : La phase de diagnostic, une étape de la démarche stratégique : diagnostic et capacités stratégiques
Partie 3 : Le diagnostic externe (environnement, macro et microéconomie de l’entreprise) : analyse de l’environnement concurrentiel de l’entreprise et de ses évolutions
Partie 4 : Le diagnostic interne (forces et faiblesses) : analyse de la performance de l’entreprise et de ses opportunités de développement
Partie 5 : Les modalités de réconciliation du diagnostic externe et du diagnostic interne
Partie 6 : Etablir une stratégie : comment passer du diagnostic à l’action ? Les processus stratégiques, le management de la stratégie : exemples de démarches stratégiques et retours d’expérience (évoqués tout au long de l’avancement du cours en guise d’illustrations)
Modalités de contrôle des connaissances
- 50 % : réalisation d’un travail personnel au cours de l’année universitaire sous la forme de la rédaction d’une note de 4 à 5 pages portant sur l’appropriation de l’un des outils présentés en cours
- 50% : examen final sous la forme d’un contrôle de connaissance
Références bibliographiques
B. Garrette, R. Durand, P. Dussauge, L. Lehmann-Ortega, F. Leroy, Stratégor, Editions Dunod, 2019, 717 pages
F. Fréry, R. Whittingon, P. Regner, D. Angwin, G. Johnson, K. Scholes, Stratégique, Editions Pearson, 2020, 697 pages.
W. Chan Kim, Renée Mauborgne, Stratégie Océan bleu, Pearson pour l’édition française, Paris, 2015
Ph. Bernoux, Sociologie des organisations, Point Seuil.
 |
Anne-Lise BARRÉ |
Objectif pédagogique
- Se familiariser avec les théories et représentations du changement.
- Expérimenter des outils et méthodes d’accompagnement du changement.
- Découvrir l’approche de l’anthropologie appliquée à l’accompagnement du changement.
Plan de cours
Le cours décline six grands axes d’un accompagnement du changement, du décryptage de l’environnement dans lequel ce changement s’inscrit, jusqu’à l’évaluation des résultats obtenus.
Chaque séance alterne exercices pratiques, études de cas, mises en situation, apports d’outils et méthodes, échanges et synthèses.
L’animation privilégie la co-construction afin d’expérimenter concrètement les bénéfices et difficultés de cette dynamique essentielle pour réussir un changement.
Séances 1 à 6 :
- Construire sa posture de consultant en accompagnement du changement : décrypter les idéologies du changement, observer les codes relationnels.
- Préparer un projet de changement : définir un vrai projet, réaliser le diagnostic, le SWOT et le pitch du projet.
- Lancer un projet de changement : évaluer les synergies et les antagonismes, négocier les conditions d’adhésion, redéfinir les positions et relations managériales.
- Mettre en action et favoriser l’engagement les acteurs : développer la co-construction dans les relations individuelles et collectives.
- Ajuster son mode de relation : décoder et synchroniser sa communication en fonction de ses interlocuteurs.
- Piloter un projet de changement : animer les réunions, gérer les tensions, réajuster, évaluer les résultats.
Séances 7 et 8 :
Présentation des travaux en sous-groupes préparés par les étudiants.
Modalités de contrôle des connaissances
Evaluation continue : participation individuelle durant chacune des séances.
Evaluation finale : présentation d’un travail réalisé en sous-groupe sur une thématique du changement.
Références bibliographiques
- BERNOUX P. Sociologie du changement, Paris, Seuil, 2004.
- CARDON A, LENHARDT V., NICOLAS P. L’analyse transactionnelle, Paris, Eyrolles,1995.
- D’HERBEMONT O., CESAR B. La stratégie du projet latéral, Paris, Dunod, 1996.
- ENRIQUEZ E., Les jeux du pouvoir et du désir dans l’entreprise, Paris, Desclée de Brouwer, 1997.
- FAUVET J. C., L’élan sociodynamique, Paris, Editions d’Organisation, 1996.
- FAUVET J. C., SMIA M. Le manager joueur de go, Paris, Eyrolles, 2006.
- REBEYROLLE M. Utopie 8 heures par jour, Paris, L’Harmattan, 2006.
 |
Pierre LOUBIGNAC |
Objectif pédagogique
Le cours a pour objectif d’aborder les notions fondamentales du management de projet et de préparer les étudiants à travailler efficacement en groupe, en utilisant des outils de collaboration en ligne. Ils abordent les principaux outils de gestion de projet pour passer de l’idée à la réalisation.
Plan de cours
Le cours s’organise autour de 4 sujets:
- Qu’est ce qu’un projet? La boîte à outils de la gestion de projet.
- La gestion du temps: Comment planifier les tâches de son projet? Comment conduire des réunions efficaces? Quel rôle prendre lors d’un meeting?
- La gestion des gens: Comment tirer le meilleur des différents types de personnes travaillant sur un projet? Comment communiquer directement tout en maintenant une relation de travail productive? Comment présenter ses idées efficacement?
- La résolution de problèmes: Comment s’assurer que notre projet est la bonne solution au bon problème?
Modalités de contrôle des connaissances
Évaluation collective : étude de cas.
 |
Philippe DESTATTE Université de Mons, Institut Destrée, PRO-TE-IN srl |
Objectif pédagogique
Très inspirée du Foresight anglo-saxon, la prospective sera abordée de manière théorique mais surtout pratique, comme un processus d’innovation et de transformation stratégique, fondé sur la systémique et le long terme, en vue de mettre en œuvre dans le présent une action opérationnelle. L’objectif de cet enseignement est de se familiariser à la prospective et à l’anticipation, de prendre conscience de leur utilité dans les entreprises, les organisations et les territoires, ainsi que de se préparer à utiliser concrètement leurs méthodes dans les métiers des études et du conseil.
Plan de cours
Le cours comprend deux parties.
La première consiste en une introduction portant sur les fondements de la prospective (temps, espace, système, changement, anticipation, stratégie, processus, concepts).
La seconde partie, plus large, se concrétise par un exercice de prospective (Blueprint) valorisant les compétences individuelles et l’intelligence collective pour comprendre et mettre en œuvre les outils et les méthodes.
Modalités de contrôle des connaissances
Épreuves de contrôle continu au travers d’exercices et remise d’un travail final d’application
Références bibliographiques
- Ian Miles, Ozcan Saritas, Alexander Sokolov, Foresight for Science, Technology and Innovation, Springer, 2016.
- Peter Bishop, Andy Hines, Teaching about the Future, New York, Palgrave Macmillan, 2012.
- Günter Clar, Philippe Destatte, Regional Foresight, Boosting Regional Potential, Mutual Learning Platform Regional Foresight Report, Luxembourg, European Commission, Committee of the Regions and Innovative Regions in Europe Network, 2006.
- Jerome C. Glenn and Theodore J. Gordon, Futures Research Methodology 3.0., Washington, The Millennium Project, 2010.
- Luke Georghiou e.a., The Handbook of Technology Foresight, Theory and Practice, Cheltenham, Elgar, 2008.
UE 4 — Méthodologie de travail
L’année débute par un séminaire de rentrée qui se déroule sur une journée, sur le site de la station d’écologie forestière de l’Université, situé à l’orée de la forêt de Fontainebleau. C’est l’occasion pour les étudiants de la nouvelle promotion de faire connaissance, entre eux et avec les responsables de l’équipe pédagogique. La philosophie du master est rappelée et le déroulement de l’année est explicitée. Les étudiants confirment leur choix d’option et, après discussion, les thèmes d’études qu’ils auront à mener au cours de l’année sont présentés.
 |
Erwan BARBIER |
Objectif pédagogique
Plan de cours
Modalités de contrôle des connaissances
Références bibliographiques
 |
Isabelle COLLIN
Statut Université |
Objectif pédagogique
Plan de cours
Modalités de contrôle des connaissances
Références bibliographiques
 |
Olivier BLANDIN PAST, Université Paris Cité & ATEMIS |
Objectif pédagogique
L’objectif de cet enseignement vise à éclairer sur les différentes dimensions à prendre en charge dans la réalisation d’une intervention de l’analyse de la demande, voire sa reformulation et l’élaboration d’une réponse (une offre d’intervention) en passant par la détermination d’une méthodologie. Il s’agira également d’indiquer l’enjeu professionnel se pouvoir articuler des enjeux d’intervention, des choix de méthodologie et la mobilisation des de connaissances théoriques issues de la recherche en sciences sociales.
Plan de cours
- Les différents types d’intervention
- Les étapes clés
- L’analyse de la demande
- La formulation d’une réponse
- Méthodologie et modes d’intervention
- La réalisation de l’intervention : quelques questionnements
Modalités de contrôle des connaissances
Travaux d’application : analyse des demandes d’intervention (direct, par appel d’offre) et échange sur des questionnements d’intervention (compréhension de la demande, conditions d’intervention, méthodologies possibles, élaboration d’une réponse).
 |
Sébastien DUBOIS Directeur des études – SUPPER by Square Management |
Objectif pédagogique
Aller au-delà du fantasme et de la science-fiction entourant la hype massive de l’IA, et comprendre l’impact de ces technologies dans les évolutions métier.
- Comprendre l’IA et ses implications visibles et invisibles.
- Explorer son impact sur les métiers du conseil et des études marketing.
- Analyser les nouvelles opportunités et les évolutions du secteur.
Ce programme permet d’aborder l’IA sous un angle technique, critique et prospectif, avec un focus spécifique sur les métiers du conseil et des études marketing.
Plan de cours
- Cycle de 4 conférences :
- L’IA, une révolution ? Comprendre ses fondements, ses mythes et ses réalités
- L’IA et ses faces cachées : une réalité complexe marquée par des invisibilités
- L’IA est la transformation des métiers du marketing et du conseil
- Quel avenir pour les métiers du conseil et des études ?
Modalités de contrôle des connaissances
Pas d’évaluation.
Références bibliographiques
UE 5 — Mémoire 1
Tout d’abord, précisons ce que le mémoire n’est pas. Le mémoire n’est pas un rapport de stage, qui consisterait à présenter la structure d’accueil durant l’alternance et le contenu des missions qui ont été confiées à l’apprenti durant l’année. Il n’est pas non plus la reproduction in extenso d’un travail réalisé durant le stage dans le cadre des missions confiées à l’apprenti. Le mémoire est un travail d’ordre universitaire. Il traite d’une question formulée clairement, argumentée et justifiée théoriquement, pratiquement et méthodologiquement.
La définition du sujet fait l’objet d’une concertation entre l’étudiant, son tuteur à l’Université et son maître d’apprentissage en entreprise. Il doit être en relation avec le contenu de la mission de l’étudiant en entreprise. Chaque étudiant doit rendre avant le 31 janvier la « fiche mémoire » indiquant le sujet de son mémoire ainsi qu’un plan prévisionnel. Cette fiche doit être signée par le maître d’apprentissage, le tuteur et l’étudiant et validée par le directeur du M2.
Le mémoire doit témoigner de l’intérêt du détour par la réflexion méthodologique et théorique pour le traitement d’une question concrète relevant de la mission confiée à un chargé d’études ou un consultant. Par ce travail, l’étudiant doit prendre conscience de l’importance de ne pas considérer comme étrangers l’un à l’autre le détour conceptuel et l’impératif de réponse opérationnelle à des questions concrètes posées par des commanditaires. L’étudiant doit adopter une attitude analytique et critique, s’attacher au dévoilement des acteurs, de leurs positions et de leurs stratégies…
Le travail de mémoire doit donc constituer une opportunité de lectures « fondamentales », de nature méthodologique et/ou théorique, dans le champ du sujet, parallèlement à l’exploitation d’études antérieures et de matériaux documentaires issus par exemple de la presse professionnelle. La rédaction doit explicitement faire référence à ces lectures. Formellement les principes académiques de présentation doivent impérativement être respectés, les auteurs et sources cités rigoureusement, les références explicites, etc. Les principes déontologiques de base (pas de copier-coller sans guillemets et citations…) doivent être scrupuleusement respectés.
Le volume total du mémoire devra se situer entre 30 et 50 pages, hors annexes.
Le tuteur dirige le travail de recherche. Dans la mesure du possible les maîtres d’apprentissage doivent aider leur stagiaire, par un soutien méthodologique et en accordant du temps durant la présence en entreprises (notamment lors de la phase de bouclage). L’entreprise gagnera un apport conceptuel ou méthodologique et le stagiaire aura en main un rapport présentant son effort à d’autres employeurs …
Une note d’étape, de 5 à 10 pages, explicitant la problématique, les partis pris retenus et défendant le plan envisagé, sera rendue autour du 20 mai. Cette note doit témoignée d’un processus de maturation de la réflexion sur le sujet et de l’avancement du travail de lecture. Évaluée par le tuteur et un autre membre de l’équipe pédagogique, elle fera l’objet d’une note qui entrera pour 20 % dans le calcul de la note de mémoire finale.
Le mémoire doit être rendu autour du 15 septembre. Il est soutenu, devant un jury composé de deux membres de l’équipe pédagogique (dont le tuteur) et du maître d’apprentissage avant la fin septembre. La soutenance, d’une durée approximative d’une heure, consiste une présentation PowerPoint d’une quinzaine de minutes au cours de laquelle l’étudiant présente sa méthodologie, ses principaux résultats et le bilan qu’il tire de son travail, suivie d’une trentaine de minutes de discussion avec le jury. La note de mémoire résulte de la moyenne de quatre notes : la note attribuée à la note d’étape, une note pour le « fond » du mémoire (coefficient 2), une note pour la qualité de la rédaction et de la présentation du rapport (coefficient 1), une note pour la qualité de la prestation orale lors de la soutenance (coefficient 1). Après délibération des membres du jury de soutenance, l’étudiant est informé de l’ordre de grandeur de sa note, la note définitive étant susceptible d’être ajustée lors du jury de diplôme à des fins d’harmonisation. La note de mémoire compte pour 30 % dans la note finale. Une note inférieure à 8 est éliminatoire.
UE 6 — Suivi et évaluation de la formation en entreprise 1
Le principe de l’alternance est que la formation repose sur l’acquisition de savoirs académiques et professionnels à l’Université, et l’acquisition de compétences pratiques au sein de la structure d’accueil. Cette dernière fait donc l’objet d’une évaluation. A trois reprises dans l’année (en février, juin et septembre), le maître d’apprentissage est invité à remplir une fiche d’évaluation de l’apprenti dont il a la charge. Il note différents aspects du travail de l’apprenti et rédige des commentaires relatifs aux compétences acquises et aux objectifs sur le plan des compétences à acquérir ou à améliorer. Sur cette base, chaque fiche débouche sur un note moyenne et la moyenne des trois notes (la note de septembre ayant un coefficient 2) fournit la note d’entreprise, qui compte pour 20 % dans la note finale.
Semestre 2
UE 7 – Transition écologique 1
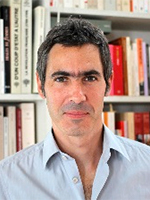 |
Antoine REBERIOUX
Professeur d’économie Université Paris Cité, LADYSS |
Objectifs
Le séminaire s’intéresse à la responsabilité des entreprises (privées) dans la transition écologique, au regard notamment des investissements nécessaires pour parvenir à la neutralité carbone. La nature de ces investissements et leur montant appellent à une réflexion sur la capacité des entreprises à se projeter dans le long terme et à trouver les financements adéquats. A cette fin, le séminaire s’intéresse spécifiquement aux dispositifs de gouvernance et de finance d’entreprise capables d’impulser les changements attendus. On répondra ainsi, et par exemple, aux questions suivantes : comment concilier rentabilité et innovations vertes ? Quels sont les dispositifs stratégiques et financiers susceptibles de favoriser les innovations vertes ? Comment se situe la France par rapport à ses principaux voisins ou compétiteurs en matière de gouvernance ?
Plan
- Séminaire 1: Les entreprises dans la transition écologique
- Séminaire 2: Entreprise et Société (de capitaux)
- Séminaire 3: Gouvernance et finance d’entreprise: approche comparative
- Séminaire 4: Souveraineté actionnariale versus responsabilité sociétale
Evaluation
- CCESE: examen final de deux heures, sur table.
- APE-ESoS: essai (à la maison) analysant en détail et de manière critique un article académique
Lectures
Il n’y a pas de manuel privilégié. En revanche, pour chaque séminaire, des articles (en anglais ou en français) seront à lire.
 |
Céline SOUBRANNE Directrice RSE et Développement Durable Lagardère – Louis Hachette Group |
Objectifs
Ce cours a pour objectif de préparer les étudiants à la RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise), dans une perspective de pratique professionnelle, en vue de son intégration dans les stratégies, politiques et plan d’action des acteurs publics et privés.
Plan du cours
- Introduction – RSE : définitions, usages professionnels.
- Analyse de matérialité, stratégie et politiques RSE : méthodologies, consultation des parties prenantes, normes et standards nationaux et internationaux, démarches volontaires et réglementaires, modèles d’affaires, mesure de performance.
- Enjeux environnementaux: climat (risques physiques et risques de transition, notions d’atténuation/adaptation), biodiversité, économie circulaire, économie de la fonctionnalité… dans les opérations propres et la chaine de valeur.
- Enjeux sociaux: égalité-diversité-inclusion, qualité de vie au travail, droits humains… pour les effectifs propres et les travailleurs de la chaine de valeur.
- Gouvernance : rôle du Conseil d’Administration et des instances dirigeantes, éthique des affaires, rôle des différentes fonctions de l’entreprise.
- Cas pratiques autour de différentes approches et de niveaux d’intégration de la RSE dans les modèles d’affaire: raison d’être, entreprises à missions, entreprises contributives et régénératrices, certifications (B Corp…) et spécificités géographiques.
Modalités du contrôle des connaissances
Exposés en binôme.
Références bibliographiques
- S.Trebucq, R.Demersseman (2023), Le Grand Livre de la RSE, Dunod.
- S.Grunfelder – G.Delalieux RSE (2023), Parties prenantes et outils, Dunod.
- J.Boissinot (2023), La Finance Verte, Dunod.
 |
Olivier BLANDIN Université Paris Cité et Atemis |
Objectif pédagogique
Plan de cours
Modalités d’évaluation
Références bibliographiques
UE 8 –Transition écologique 2
 |
David GARBOUS
Directeur général Transformations Positives |
Objectif pédagogique
Plan de cours
Modalités de contrôle des connaissances
Références bibliographiques
 |
Thomas LAMARCHE Professeur d’économie, Université Paris CIté, Ladyss |
Objectif pédagogique
Plan de cours
Modalités de contrôle des connaissances
Références bibliographiques
UE 9 –Transition écologique 3
 |
Annabelle RICHARD Directrice Conseil Utopies |
 |
Boris CHABANEL Expert économies locales Utopies |
Présentation du cours
Dans un contexte global de polycrises – sanitaire, géopolitique, climatique, énergétique, démocratique… –, la transformation des modèles économiques aussi bien du côté des territoires que des entreprises est devenu un enjeu de premier plan. Tout l’enjeu aujourd’hui est de mettre en synergies les initiatives engagées pour maximiser l’effet levier à ces deux échelles.
C’est pourquoi cet enseignement propose des éclairages, des leviers d’action et des exemples inspirants portant à la fois sur les nouveaux paradigmes du développement économique territorial et sur les enjeux et leviers de transformation des entreprises.
Cet enseignement poursuit plus précisément les objectifs suivants :
- Partager des éléments d’argumentaire sur les vulnérabilités des modèles économiques dominants et l’apport de nouveaux paradigmes visant à concilier prospérité, résilience et soutenabilité des territoires.
- Maîtriser les enjeux de transformation des modèles d’affaires des entreprises dans un contexte règlementaire en mutation (RSE) et sous l’angle de l’ancrage local.
- Mettre à disposition une boîte à outils cohérente et ambitieuse pour renouveler les politiques économiques locales et accompagner la transition et l’ancrage des entreprises.
- Donner à voir des exemples d’initiatives inspirantes de territoires et d’entreprises
Format des séances
- 6 séances de 3h x 3h + une séance finale d’examen en binôme
- Déroulé d’une séance : 3h avec apport théorique (1h30) + 1 ou plusieurs retours d’expérience + 1 mise en situation (45mn)
Contrôle des connaissances : examen de 2h, comprenant une soutenance orale de 20mn + note de synthèse
Programme du cours
FACE 1. Face aux polycrises, renouveler notre approche du développement économique territorial
Séance 1 : Le modèle économique dominant (captation de richesses) et ses angles morts
- Une perte de prospérité socio-économique
- Une dépendance croissante au marché global
- Une empreinte environnementale insoutenable
Séance 2 : “Métabolisme” des territoires : une approche renouvelée des diagnostics économiques
- Présentation des métriques du métabolisme économique territorial et analyses associées
- Etude de cas : analyse d’un diagnostic territorial : mémo en 2 pages et de premières recommandations
Séance 3 : Une boite à outils pour renforcer le circuit économique local
- Une nouvelle approche du développement économique pour concilier prospérité, résilience et soutenabilité : consolider le circuit économique local
- Temps d’interaction (quizz, réactions, Q/R…) + Mise en situation : vous explorez comment résoudre une situation problématique sur le territoire en explorant des leviers de la boîte à outils
FACE 2. RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ANCRAGE LOCAL DES ENTREPRISES : ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LES TERRITOIRES
Séance 1 : à la découverte des modèles économiques hyper-locaux
- Modèle économique d’entreprise, de quoi parle-t-on ?
- De la RSE aux modèles économiques à impact
- De la RTE à l’entreprise hyperlocale
>> Etude de cas : catégorisation d’exemples réussis par typologie de modèle économique ou de contre-exemples d’entreprises ancrées localement, avec analyse des failles du modèle
Session 2 : l’ancrage local en pratique
- Quels outils activer pour les entreprises ? Chaîne de valeur, empreinte nature / climat, goodwill territorial, synergies locales…
- Vers de nouvelles organisations territoriales des entreprises : gouvernance, concertation locale, territorialisation de la stratégie…
- REX de missions d’ancrage local x transition écologique menées par Utopies auprès d’entreprises de tous secteurs (énergie, alimentation, média, bancaire…)
Mise en situation : Vous êtes responsable RSE et vous devez gérer une situation mettant en péril votre activité (plusieurs aléas proposés), vous avez rdv avec votre directeur général dans 20mn : expliquez-lui pourquoi l’ancrage local est un levier pour gérer et peut-être dépasser cette crise.
Session 3 : l’ancrage, levier de robustesse des entreprises – Découverte de l’Atelier tumulte x HYPERLOCAL
- Présentation du serious game Tumulte co-développé par Utopies et Opeo pour la Métropole de Lyon
- Répartition des participants en quatre groupes (4 filières clés : BTP, agro-alimentaire, mobilité, textile) et animation de l’atelier par Utopies – Jeu de rôle avec constitution d’un binôme DG Entreprise x Elu au développement économique local pour renforcer l’ancrage de l’entreprise et sa filière
- Présentation du déroulé de l’examen
Session 4 : Soutenance des feuilles de routes croisée entreprises/collectivités
- Mise en commun et débrief, soutenance
- Livrable : business model canevas – 2h : 30mn de soutenance par groupe avec note de synthèse associée
UE 10 — Anglais

ANGLAIS (28 h)
Linda VIRECOULON
Objectif pédagogique :
Cet enseignement est axé sur la pratique de l’anglais professionnel et académique, avec un renforcement des bases grammaticales, lexicales et en prononciation. Il y aura des séances d’expression, exposés, débats, activités de vocabulaire, développement des compétences langagières de compréhension, expression en continu et interaction orale. L’objectif consiste à gommer les inhibitions restantes et à tendre vers un anglais fluide, efficace et convaincant .
Vous aurez aussi une préparation condensée au test du TOEIC.
Plan de cours :
- Évaluation de votre niveau et présentation des objectifs
- Révision des bases grammaticales
- Prononciation
- Élargissement du vocabulaire académique et professionnel
- Présentations et discussions
- Préparation au Test du TOEIC
Contrôle des connaissances :
Présentation orale sur un sujet lié à vos études ou votre travail. L’épreuve se fera pendant les cours, en 15-20 minutes, entièrement en anglais et cela sera suivi d’une discussion avec le reste de la classe.
Vous serez notés sur votre précision lexicale, grammaticale, votre capacité à susciter l’intérêt de votre public ainsi qu’à communiquer de manière organisée, claire et efficace, tout en développant un sujet complexe. La discussion qui suivra est aussi notée pour vous encourager à poursuivre sur des échanges plus ou moins improvisés.
Bibliographie indicative :
– DAVENPORT, Lila. English Phrasal Verbs : Les verbes à particules en anglais. 2e éd. Paris : Ellipses, 2012. (Optimum)
– MALAVIEILLE, Michèle, ROTGE, Wilfrid. La grammaire anglaise. Paris : Hatier, 2000. (Bescherelle)
– Raymond Murphy, English Grammar in Use, with answers éditions Cambridge University Press OU Martin Hewings Advanced Grammar in Use with Answers
– Paulette Dale, English Pronunciation Made Simple, Longman, 2003
UE 11 – Itinéraire Marketing
Uniquement pour les étudiants de l’option MK.
 |
Bertrand de LA SELLE Associé d’Equancy – Cabinet de Conseil en Transformation Data et Digitale |
Objectif pédagogique
Le cours retrace une perspective historique du marketing, de son histoire et de sa mesure, à travers de très nombreux exemples et illustrations. Il décrit en détail l’ensemble des indicateurs et outils permettant d’estimer le succès des activités marketing. Enfin il replace le marketing dans son environnement d’entreprise (modèle économique et innovation)
Plan de cours
- Introduction au marketing
- Introduction aux principes de mesure
- Panorama des indicateurs du marketing offline
- Indicateurs et mesures du marketing digital
- Indicateurs marketing et économiques
- Innovation marketing
Modalités de contrôle des connaissances
25% sur la participation active en cours
50% sur un exposé à réaliser en groupe
25% sur une évaluation finale
Références bibliographiques
- Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan (2012), Marketing 3.0 : Produits, Clients, Facteur Humain, Bruxelles, De Boeck
 |
Frédéric Lefebvre-Naré Directeur data, Niji |
Objectif pédagogique
Le cours revisite les techniques d’études marketing dans le contexte de la datification, c’est-à-dire de l’accès à une masse d’information touchant les comportements de consommation (d’usage, de navigation…) et les attitudes (à travers les textes librement rédigés par les personnes).
Ces données permettre de suivre la quasi totalité du « marketing funnel », et de combiner étroitement « quali » et « quanti ».
Le cours comprendra principalement :
- Une initiation au « dashboarding » (business intelligence, data analytics) sur données marketing ;
- Une pratique de la classification non supervisée de textes, comme outil pour découvrir et structurer les attitudes ou représentations des personnes sur un sujet donné.
Modalités de contrôle des connaissances
25% sur la participation active aux cours
75% par des contrôles en salle, qui pourront être répartis au cours du semestre (au fil des sujets traités), et peuvent inclure des exposés individuels rapides, réalisés en classe à partir de documents.
Références bibliographiques
-
- Delphine Dion (dir.), A la recherche du consommateur : Nouvelles techniques pour mieux comprendre le client, Dunod 2008
- Steven Gittelman et Elaine Trimarchi, « Online research … And all that jazz! The practical adaptation of old tunes to make new music», Online Research, 2010. Téléchargeable à ce lien.
- Robert V. Kozinets, Netnography: The Essential Guide to Qualitative Social Media Research, Sage, 2019 (3e éd.)
- Dominique Boullier et Audrey Lohard, Opinion mining et sentiment analysis. Méthodes et outils, OpenEdition Press, 2012
- Guides d’initiation à la BI de Microsoft https://docs.microsoft.com/fr-fr/power-bi/fundamentals/desktop-getting-started ou Google https://support.google.com/datastudio/answer/9171315?hl=fr&ref_topic=6267740
 |
Laurent BUTERY Lactalis |
Objectif pédagogique
L’objectif de cet enseignement est double :
– il s’agit de réaliser une étude de marché pour une institution et mettre ainsi en pratique les enseignements théoriques dispensés dans le cadre du master,
– le cours doit également permettre aux étudiants de renforcer leur position au sein de leur organisation : dans un environnement en crise(s), de plus en plus agile et digitalisé, les fonctions études et conseil doivent pouvoir analyser et expliquer des phénomènes complexes avec simplicité. A ce titre, elles doivent apporter des réponses business court terme et proposer une réflexion stratégique sur le long terme.
Plan de cours
L’objectif de cet enseignement est double :
– il s’agit de réaliser une étude de marché pour une institution et mettre ainsi en pratique les enseignements théoriques dispensés dans le cadre du master,
– le cours doit également permettre aux étudiants de renforcer leur position au sein de leur organisation : dans un environnement en crise(s), de plus en plus agile et digitalisé, les fonctions études et conseil doivent pouvoir analyser et expliquer des phénomènes complexes avec simplicité. A ce titre, elles doivent apporter des réponses business court terme et proposer une réflexion stratégique sur le long terme.
Modalités de contrôle des connaissances
Réalisation des travaux tout au long de l’enseignement (50 %) + présentation finale (50 %).
Bibliographie indicative
Giannelloni J.L. et Vernette E. (2019), Etudes de marché, Editions Vuibert
Millier P. (2002), L’étude des marchés qui n’existent pas encore, Editions d’organisation
Desjeux D. (2006), La consommation, Editions Presses Universitaires de France Que sais-je
UE 12 – Itinéraire Organisation, Emploi, Travail
Uniquement pour les étudiants de l’option OET.
 |
Romain DEMISSY Maître de conférences en économie, Université de Paris |
Objectif pédagogique
Plan de cours
Modalités de contrôle des connaissances
Références bibliographiques
 |
Eric MAGNIN Professeur d’économie Université Paris Cité |
Objectif pédagogique
Dans le cadre des théories de l’organisation, cet enseignement accorde une large place aux thèmes de la motivation et de la satisfaction au travail mais aussi à la non-satisfaction et à la souffrance. Ce cours s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire, mobilisant économie, sociologie et psychologie. Au-delà de l’apport de grilles de lecture essentielles pour toute personne désirant travailler dans le domaine des ressources humaines, l’objectif du cours est aussi de confronter ces approches à l’expérience organisationnelle des étudiant.e.s et d’en discuter collectivement le bien-fondé.
Plan de cours
Introduction : retour sur les concepts de motivation, satisfaction, implication
I – Motivations et approche par les besoins
II – Travail et souffrance au travail
III – Les nouvelles pathologies du travail
Modalités de contrôle des connaissances
Dossier réalisé à partir de l’expérience organisationnelle des étudiants.
Références bibliographiques
- P.Bernoux, La sociologie des organisations, Essais Points, Seuil, 1985.
- C.Deours, Travail, usure mentale, 3è éd., 2000.
- C.Lévy-Leboyer, La motivation au travail. Modèles et stratégies, 3è éd., 2006.
- P.Roussel, Rémunération, motivation et satisfaction au travail, Économica, 1996.
 |
Camille SIGNORETTO Maître de conférences en économie, Université de Paris, LADYSS |
Objectif pédagogique
Le cours d’analyse des métiers, des emplois et des qualifications (AMEQ) s’insère dans le parcours OET du master CCESE. Il vise à donner aux étudiants des clés de compréhension et des outils d’analyse des évolutions des emplois et des métiers dans l’objectif d’anticiper les besoins en qualifications, si ce n’est en compétences, à l’échelle d’un secteur, d’un territoire ou d’une entreprise.
Plan de cours
Après une introduction revenant sur les principales notions d’analyse des métiers, des qualifications et des compétences (GPEC, GRH territorialisée, types de classifications des métiers et des secteurs), ainsi que de prospective, puis sur leurs présupposés théoriques ; une première partie visera à dresser un état des lieux des pratiques de prospective des emplois et des métiers mis en œuvre par différents acteurs institutionnels (Dares-Ministère du Travail, France Stratégie, Observatoires Régionaux des Métiers, Observatoires Prospectifs des Métiers et des Qualifications de branches, Cedefop, OCDE, etc.) ; puis une seconde partie reposera sur des mises en application sur des secteurs et/ou territoires à partir de différentes méthodes. Cette dernière partie se concrétisera pour les étudiants par la réalisation d’un rapport d’expertise utilisant l’une des méthodes sur un secteur ou territoire choisi.
Modalités de contrôle des connaissances
Les étudiant-e-s sont évalué-e-s individuellement et collectivement en 100% CC.
Le contrôle des connaissances reposera sur deux types d’évaluation : réalisation d’un rapport d’expertise par groupe d’étudiants avec présentation orale en fin de semestre et évaluation par les pairs (70% de la note) ; rendus ponctuels tout au long du semestre (fiches, notes, étapes d’avancement du rapport ; 30% de la note).
Références bibliographiques
- France Stratégie – Dares (2015), « Les métiers en 2022 », Rapport du groupe Prospective des métiers et des qualifications, avril.
- France Stratégie – Dares (2018), Prospective des Métiers et Qualifications (PMQ) : bilan et perspectives, février.
- Loubès, A. et Bories-Azeau, I. (2016), « Les logiques de la GPEC élargie au territoire : une proposition de typologie », Gestion 2000, volume 33(2), pp. 141-160.
UE 13 — Mémoire 2
Tout d’abord, précisons ce que le mémoire n’est pas. Le mémoire n’est pas un rapport de stage, qui consisterait à présenter la structure d’accueil durant l’alternance et le contenu des missions qui ont été confiées à l’apprenti durant l’année. Il n’est pas non plus la reproduction in extenso d’un travail réalisé durant le stage dans le cadre des missions confiées à l’apprenti. Le mémoire est un travail d’ordre universitaire. Il traite d’une question formulée clairement, argumentée et justifiée théoriquement, pratiquement et méthodologiquement.
La définition du sujet fait l’objet d’une concertation entre l’étudiant, son tuteur à l’Université et son maître d’apprentissage en entreprise. Il doit être en relation avec le contenu de la mission de l’étudiant en entreprise. Chaque étudiant doit rendre avant le 31 janvier la « fiche mémoire » indiquant le sujet de son mémoire ainsi qu’un plan prévisionnel. Cette fiche doit être signée par le maître d’apprentissage, le tuteur et l’étudiant et validée par le directeur du M2.
Le mémoire doit témoigner de l’intérêt du détour par la réflexion méthodologique et théorique pour le traitement d’une question concrète relevant de la mission confiée à un chargé d’études ou un consultant. Par ce travail, l’étudiant doit prendre conscience de l’importance de ne pas considérer comme étrangers l’un à l’autre le détour conceptuel et l’impératif de réponse opérationnelle à des questions concrètes posées par des commanditaires. L’étudiant doit adopter une attitude analytique et critique, s’attacher au dévoilement des acteurs, de leurs positions et de leurs stratégies…
Le travail de mémoire doit donc constituer une opportunité de lectures « fondamentales », de nature méthodologique et/ou théorique, dans le champ du sujet, parallèlement à l’exploitation d’études antérieures et de matériaux documentaires issus par exemple de la presse professionnelle. La rédaction doit explicitement faire référence à ces lectures. Formellement les principes académiques de présentation doivent impérativement être respectés, les auteurs et sources cités rigoureusement, les références explicites, etc. Les principes déontologiques de base (pas de copier-coller sans guillemets et citations…) doivent être scrupuleusement respectés.
Le volume total du mémoire devra se situer entre 30 et 50 pages, hors annexes.
Le tuteur dirige le travail de recherche. Dans la mesure du possible les maîtres d’apprentissage doivent aider leur stagiaire, par un soutien méthodologique et en accordant du temps durant la présence en entreprises (notamment lors de la phase de bouclage). L’entreprise gagnera un apport conceptuel ou méthodologique et le stagiaire aura en main un rapport présentant son effort à d’autres employeurs …
Une note d’étape, de 5 à 10 pages, explicitant la problématique, les partis pris retenus et défendant le plan envisagé, sera rendue autour du 20 mai. Cette note doit témoignée d’un processus de maturation de la réflexion sur le sujet et de l’avancement du travail de lecture. Évaluée par le tuteur et un autre membre de l’équipe pédagogique, elle fera l’objet d’une note qui entrera pour 20 % dans le calcul de la note de mémoire finale.
Le mémoire doit être rendu autour du 15 septembre. Il est soutenu, devant un jury composé de deux membres de l’équipe pédagogique (dont le tuteur) et du maître d’apprentissage avant la fin septembre. La soutenance, d’une durée approximative d’une heure, consiste une présentation PowerPoint d’une quinzaine de minutes au cours de laquelle l’étudiant présente sa méthodologie, ses principaux résultats et le bilan qu’il tire de son travail, suivie d’une trentaine de minutes de discussion avec le jury. La note de mémoire résulte de la moyenne de quatre notes : la note attribuée à la note d’étape, une note pour le « fond » du mémoire (coefficient 2), une note pour la qualité de la rédaction et de la présentation du rapport (coefficient 1), une note pour la qualité de la prestation orale lors de la soutenance (coefficient 1). Après délibération des membres du jury de soutenance, l’étudiant est informé de l’ordre de grandeur de sa note, la note définitive étant susceptible d’être ajustée lors du jury de diplôme à des fins d’harmonisation. La note de mémoire compte pour 30 % dans la note finale. Une note inférieure à 8 est éliminatoire.
UE 14 — Suivi et évaluation de la formation en entreprise 2
Le principe de l’alternance est que la formation repose sur l’acquisition de savoirs académiques et professionnels à l’Université, et l’acquisition de compétences pratiques au sein de la structure d’accueil. Cette dernière fait donc l’objet d’une évaluation. A trois reprises dans l’année (en février, juin et septembre), le maître d’apprentissage est invité à remplir une fiche d’évaluation de l’apprenti dont il a la charge. Il note différents aspects du travail de l’apprenti et rédige des commentaires relatifs aux compétences acquises et aux objectifs sur le plan des compétences à acquérir ou à améliorer. Sur cette base, chaque fiche débouche sur un note moyenne et la moyenne des trois notes (la note de septembre ayant un coefficient 2) fournit la note d’entreprise, qui compte pour 20 % dans la note finale.