Les chargés d’études et les consultants sont des professionnels de l’aide à la décision. Dans un contexte économique et social de plus en plus complexe et en évolution permanente, de transformations écologiques majeures, les responsables dans les entreprises, les administrations, les collectivités locales… ont besoin d’asseoir leurs décisions stratégiques sur des diagnostics approfondis de leur environnement et d’être accompagnés par la mise en œuvre de méthodologies rigoureuses. Les chargés d’études et les consultants sont donc de véritables agents du changement.
Le travail des chargés d’études et des consultants peut schématiquement être comparé à celui d’un compilateur d’informations : par l’absorption d’une grande diversité d’informations, par leur traitement au moyen des méthodologies adaptées et leur interprétation au travers de grilles d’analyse pertinentes, ils produisent un diagnostic, des résultats, des recommandations, de nature à éclairer la décision, voire participent à leur mise en œuvre puis à leur évaluation.
Pour mener à bien sa mission, le chargé d’études et le consultant doivent maîtriser trois grands blocs de savoirs :
1. La collecte ou la création d’informations, par la maîtrise des techniques appropriées : recherche documentaire, réalisation d’enquêtes quantitatives ou qualitatives, aspiration de données numériques, consultations d’experts, entretiens auprès de consommateurs, observation de terrain…
2. Le traitement de cette information pour en tirer des éléments de connaissance pertinents par rapport au problème à traiter. Ce processus de transformation de l’information en connaissances suppose des compétences dans le domaine du traitement des données statistiques, de l’utilisation de l’IA, de l’analyse de contenu… mais aussi la mobilisation de concepts, de grilles d’analyse, de théories permettant de donner du sens aux informations brutes.
3. La transmission des connaissances vers les décideurs sous la forme la plus efficace, ce qui nécessite l’utilisation de techniques de visualisation des données et de communication écrite ou orale appropriées.
Le chargé d’étude et le consultant dans le processus de prise de décision
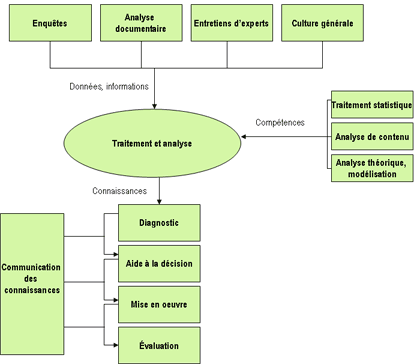
Le contenu pédagogique de la formation a été élaboré autour de ces trois grands blocs de savoirs :
- un premier ensemble de matières porte sur les méthodologies d’acquisition de l’information, avec un accent sur les techniques d’enquête.
- Un deuxième bloc de matières vise à développer la capacité d’analyse du futur consultant-chargé d’études, par l’apprentissage des méthodes de traitement des données d’enquêtes (quanti et quali), mais aussi par le renforcement de la culture générale sur les questions économiques et sociales. De plus, une place significative est accordée aux enseignements consacrés à la transition écologique. Par le choix d’un bloc optionnel (voir plus bas), chaque étudiant peut choisir d’orienter l’acquisition des éléments méthodologiques en faveur du champ du « marketing » ou de celui de « l’organisation, de l’emploi et du travail ».
- Un troisième ensemble de matières porte sur les méthodes de communication écrite et orale.
Des travaux d’application, individuels ou collectifs, sont associés à la plupart des enseignements. Au cours de chacune des 2 années, les étudiants sont mis en situation professionnelle au travers de la réalisation d’un mémoire, d’une étude ou d’une mission grandeur réelle.
L’année de M1 est consacrée à l’approfondissement de la formation en sciences sociales, dans une optique résolument pluridisciplinaire, et à l’initiation aux méthodes quantitative et qualitative en usage dans le secteur des études et du conseil. Les étudiants ont a réalisé un mémoire, impliquant un terrain, encadré par un membre de l’équipe pédagogique. Réalisé en binôme, ce mémoire s’efforce de répondre à une problématique en mobilisant des données qualitatives ou quantitatives, dans l’esprit d’une étude socioéconomique professionnelle.
L’année de M2 se concentre davantage sur la professionnalisation. Elle est en alternance. L’étudiant-apprenti partage donc son temps entre travail dans sa structure d’accueil et travail à l’Université. Dans ce cadre, il rédige un mémoire, dont le sujet est lié à son activité dans la structure d’accueil et qui implique une démarche conceptuelle ou méthodologique.